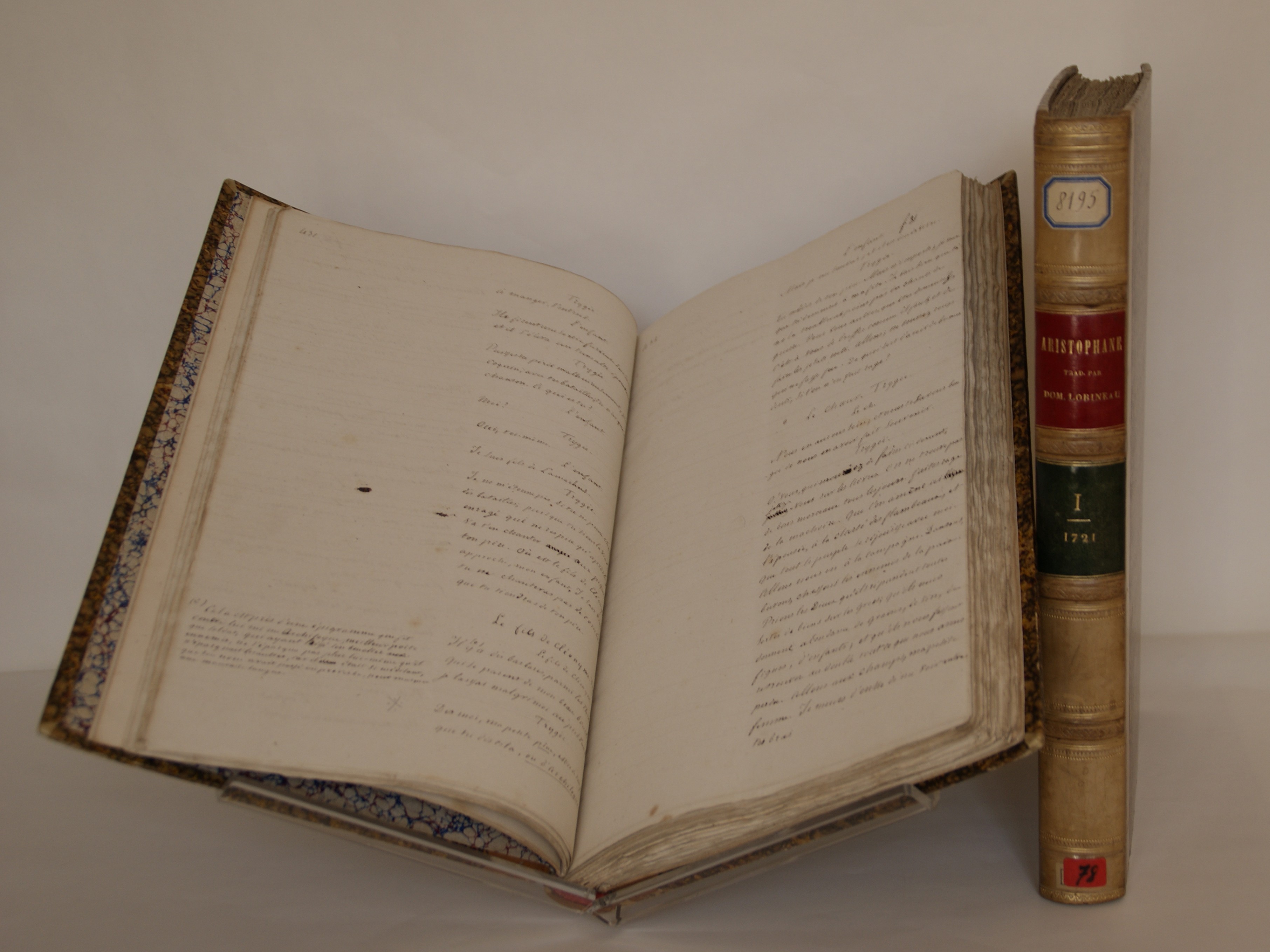 L'Aristophane de Lobineau
L'Aristophane de Lobineau
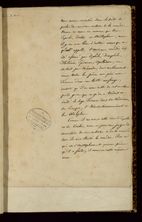
01
pré[?]face2-b-verso►
Nous aurons occasion dans la suite de parler des anciens auteurs de la comédie. Horace ne nous en nomme que trois : Eupolis, Cratin et Aristophane ; mais il y en a bien d'autres avant que ce qu'on appelle l'ancienne comédie eût été reformé par Diphile, Demophile, Philémon, Epicarme, Apollodore, et surtout par Ménandre, dont malheureusement toutes les pièces ont péri avec Térence dans un triste naufrage ; ensorte qu'il ne nous reste de cet excellent poëte grec que ce qu'en a traduit ou imité le sage Térence dans son Adrienne, son Eunuque, l'Héautontimoroumenos et les Adelphes.
Comme il ne nous reste rien d'Eupolis et de Cratin, nous ne pouvons juger du caractère de ces auteurs ni de la manière dont ils ont traité la comédie. Pour ce qui est d'Aristophane, de quinze pièces qu'il a faites, il nous en reste encore onze
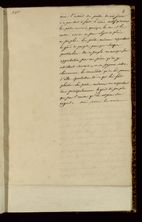
02
pré[?]face d.V°.[?]►
mais l'intérêt des poëtes de nos jours n'a pas tout à fait le même motif qu'avaient les poëtes anciens, quoique les uns et les autres aient pour objet de plaire au peuple. Les poètes modernes respectent le goût du peuple, parce que chaque particulier de ce peuple ne marque son approbation pour une pièce qu'en y assistant souvent, et en payant assez chèrement la commodité qu'on lui procure d'être spectateur de ce qui lui fait plaisir. Les poëtes modernes ne respectent donc principalement le goût du peuple que par l'amour qu'ils ont pour son argent. Mais parmi les anciens

03
[?]pré[?]face Recto[?] au bas►
On a déjà dit qu'il avait fait quinze comédies dont il nous en reste onze. On n'a pas suivi l'ordre des temps dans l'arrangement où elles ont été imprimées ; mais on l'a suivi dans cette traduction, et on va en donner la preuve.
La comédie d’Aristophane qui nous paraît devoir marcher la première est les Daitalées ou Le Banquet. Cette pièce est perdue, et tout ce que l'on en sait, c'est qu'il y avait un dialogue pareil à celui du juste et de l'injuste des Secondes Nuées ; et que cette pièce fut adoptée par Cléonide et Callistrate.
La seconde comédie fut celle des Babyloniens, perdue comme les Daitalées, et qui fut faite l'année d'avant les Acarniens. Aristophane y raillait trop librement l'état et la magistrature. Cléon en prit occasion de le faire censurer et l'accusa même d'être étranger ; ce qui ne se trouva pas vrai. Les chevaliers prirent le parti d'Aristophane, accusèrent Cléon par représailles d'avoir tiré de l'argent des villes sujettes et alliées, et le firent condamner à refondre cinq talents. Le poète marqua sa reconnaissance à cette partie du peuple en faisant la pièce qui porte

04
pré[?]face►
porte leur nom, dont nous parlerons bientôt.
La date des Acarniens est marquée précisément par ce que le poëte fait dire au bon Dicéopolis : qu'il revoit enfin la paix au bout de six ans. La guerre du Péloponnèse commença l'an du monde 3541. Ainsi cette pièce fut jouée l'an 3546 aux Bacchanales d'automne. Il y est marqué dans un endroit que c'est la première pièce où l'auteur ait fait parler les anapestes en sa faveur. Il ne négligea pas cette pratique dans les pièces suivantes. Il n'y en a guères où les anapestes ne fassent son éloge ou son apologie. Aristophane fait dans les Acarniens une opposition merveilleuse des biens de la paix et des maux de la guerre. Le contraste de Lamaque appelé à une expédition militaire où il est blessé, et de Dicéopolis invité à une fête où il fit bonne chère, est impayable.
La quatrième pièce, selon l'ordre des temps, est celle qui porte pour titre Les Chevaliers. Il y est dit que le peuple était logé à l'étroit depuis huit ans ; ce qui marque précisément l'an 3548. Et cela est confirmé par ce que le poëte y dit de l'affaire de Pyle comme récente. Or cette
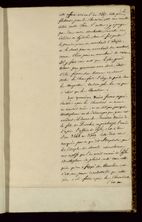
05
pré[?]face►
cette affaire arriva l'an 3547. Cette pièce, flatteuse pour les Chevaliers, est une cruelle satire contre Cléon. L'auteur n'y épargne pas deux autres archontes, Eucrate et Callias ou Lysiclès, dont il fait passer le premier pour un marchand d'étoupes, et le second pour un marchand de moutons, comme Cléon pour un marchand de cuir. Il y fait voir aussi que le plus grand talent pour gouverner avec succès, était d'être fripon, sans honneur et sans vertu. Le Chœur fait l'éloge du poëte dans les Anapestes. On dira plus bas ce que c'était que les Chevaliers.
Les premières Nuées furent présentées après les Chevaliers et eurent un mauvais succès ; on ne sait pas pourquoi. Aristophane ne se découragea pas pour cet accident ; il donna les Secondes Nuées à la fête de Bacchus, au printemps, l'année d'après l'affaire de Pyle, c'est-à-dire en l'an 3548 ou 3549. Cette date est marquée par ce que dit Strepsiade, que les disciples de Socrate ressemblaient aux captifs que l'on avait amenés à Pyle. Aristophane se plaint aussi dans cette pièce qu'on a frippé ses Chevaliers ; et c'est une preuve incontestable que cette pièce a été faite après les Chevaliers. C'est une
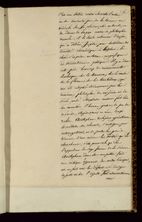
06
pré[?]face►
C'est une satire contre Socrate. L'auteur
ne se contente pas de le tourner en ridicule sur sa philosophie naturelle, et de
donner du soupçon contre sa philosophie morale ; il le traite nettement d'impie qui
a détrôné Jupiter pour substituer des divinités
chimériques à la place. Le chœur s'exprime
en termes magnifiques et véritablement poétiques. Il y a dans cette pièce beaucoup
de raisonnements burlesques sur le tonnerre, sur la cause de la flamme, sur le
tourbillon, qui ont été adoptés sérieusement par les nouveaux philosophes de nos
jours et ceux du siècle passé. Strepsiade conserve fort bien son caractère d'homme grossier, de peu de
mémoire, stupide, mais en même temps malin. Aristophane turlupine agréablement la méthode de Socrate, d'enseigner par les interrogations, et de porter les gens à
découvrir d'eux-mêmes la vérité qu'ils cherchent ; c'est pour cela qu'ils
l'appellent la sage-femme de la science. Aristophane dans ses anapestes fait une critique vigoureuse des autres
Comiques, et en fait voir les défauts. Le dialogue du juste et de l'injuste faitsignale admirablement voir

voir les effets de la bonne et de la mauvaise éducation, et le goût que la corruption du siècle donne pour la mauvaise. Le chœur fait ce que dit Horace ; il donne du secours à l'acteur, prend son parti, blâme le vice, loue la vertu, &c
L'unité de lieu n'est pas trop bien observée dans les Nuées. Tout se passe, tantôt dans la chambre de Strepsiade, tantôt à la porte de Socrate, dans sa cour, dans la place &c. Ce défaut se trouve encore dans quelques autres pièces de notre auteur, qui n'a pas été plus scrupuleux sur l'unité de temps ; aussi était-il né avant les règles. Le dénouement des Nuées est plein de bon sens, et fait voir que la mauvaise éducation que les pères donnent à leurs enfants, tourne souvent à leur propre préjudice. C'est une erreur assez communément reçue, que cette pièce fut cause de la mort de Socrate ; mais si elle en fut la cause, elle opéra bien lentement, puisque cette comédie ne fut représentée tout au plus tôt

08
pré[?]face►
au plus tôt que l'an 3548, et que Socrate ne mourut qu'en l'an 3572, cinq ans après la prise d'Athènes par Lysandre.
Les Guêpes furent représentées après les Chevaliers et après les Nuées. Voici la preuve du premier. Xanthias dit : Il ne faut point s'attendre que Cléon, dans l'éclat de sa fortune, reçoive encore quelques traits de satire de notre part. Il est encore dit en un autre endroit, par le chœur, qu'il a fallu que le poëte ait eu une hardiesse extrême pour attaquer un monstre pareil à Cléon. La preuve de ce que cette pièce a été faite après les Nuées, se prend de ce qui est dit dans celle-ci d'une comédie représentée l'année précédente, où l'on faisait voir les désordres et la corruption des enfants qui affligeaient les pères ; ce qui ne peut s'entendre que des Secondes Nuées. Au reste cette comédie est l'original que Racine a imité dans ses Plaideurs ; et c'en est assez pour faire connaître qu'il s'agit ici d'un vieillard entêté de juges, renfermé par son fils qui tâche de lui persuader qu'il sera plus heureux de renoncer à la chicane. On juge de même ici, non pas par un chien Citron qui a mangé un chapon

09
pré[?]face►
chapon du Mans, mais le chien Cydathénée qui a mangé un fromage. Cette pièce paraît plus longue qu'il ne faut par l'épisode du changement de vie et de conduite du vieillard, quoique cet épisode ait son mérite et soit très divertissant.
On ne fait pas la date précise des Femmes à la Fête de Cérès ; le seul caractère de temps que l'on y trouve, c'est que cette comédie a été faite et représentée pendant la guerre ; et qu'il paraît qu'à la représentation il y avait des troupes et des officiers d'armée. Cette pièce est une satire contre Euripide, qu'on y représente parlant par phrases subtiles, en disant de grandes balivernes avec mystère et emphase, en débitant gravement des raisonnements chimériques où il n'y avait pas l'ombre de bon sens. Il y est aussi dépeint comme calomniateur des femmes et leur ennemi, et comme un homme de plein de ruses et d'inventions.
On ne sait dans quel temps placer les Anguilles. C'est une des pièces d'Aristophane que nous n'avons plus. Tout ce que l'on en sait, au rapport d'Aristophane même, c'est que cette comédie

10
pré[?]face►
comédie aurait été faite contre Hyperbole, successeur de Cléon, et par conséquent après la mort de Cléon, qui arriva l'an 3550 ou 3551.
La date précise de la Comédie qui porte pour titre La Paix, est marquée par ce qui est dit dans le sacrifice par le Chœur : il y a treize ans que nous n'avions vu la paix. Ainsi cette comédie a été donnée en 3559. Aussi y remarque-t-on la mort de Brasidas et de Cléon arrivée l'an 3550 ou 3551. Il y avait trois ans qu'on n'avait eu de comédie quand on représenta celle-ci. Cette interruption pourrait être un effet du règlement de l'archonteEuthymène, qui s'était avisé de proscrire la comédie. Mais la comédie était un mal nécessaire, et le règlement ne fut exécuté que pendant trois ans. Quoique l'auteur blâme ici la coutume qu'avaient les poëtes de se faire louer eux-mêmes dans les anapestes que le chœur récitait, il n'a pas laissé de suivre l'usage établi, pour n'être pas le seul qui négligeât de se donner du relief par ses propres éloges. L'ouverture de la pièce est bouffone et ridicule ; du reste on représente
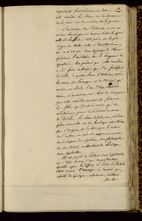
11
pré[?]face►
représente fort naïvement dans cette comédie les biens et les douceurs de la paix et les misères de la guerre.
L'ouverture des Oiseaux n'est ni moins burlesque ni moins ridicule que celle de la Paix. Cette pièce est la plus longue de toutes celles d'Aristophane, et ce n'est pas sans sujet que le chœur prévient l'auditoire sur la longueur du spectacle. On prétend que cette comédie a été faite du temps où l'on fortifiait Décélie à quatre lieues d'Athènes après la mort de Lamaque et de Nicias, qui arriva en Sicile en l'an 3549. Peut-être même n'aurait-on pas tort de s'imaginer que cette comédie aurait été faite pour les fêtes qui se célébrèrent pour la dédicace des murs de Décélie. Le chœur développe une philosophie nouvelle et de burlesque invention sur l'origine des terres et le dessein de l'auteur en cela est apparemment de se moquer du système des philosophes de son temps, et surtout de Prodique, vain sophiste.
Il est parlé du Probule dans Lysistrate, et c'était le nom d'une magistrature établie après la défaite de la Sicile. Le Probule était comme l'exarque du Conseil qui, assité de quelques assesseurs, veillait sur les

12
pré[?]face►
sur les neuf magistratures qui, avec l'archonte, avaient la principale autorité, pour empêcher qu'ils ne fissent rien contre l'état. Aussi cette pièce ne peut-elle avoir été représentée qu'après l'an 3559. Il est dit encore dans un endroit : il n'y a pas longtemps que je voyais Démostrate qui levait des troupes pour aller en Sicile. Ce qui prouve que cette pièce a été faite peu de temps après l'échec que reçut la république d'Athènes pour son entreprise de Sicile. Cette pièce finit par une paix que l'on suppose qui se fait entre les deux républiques ennemies, après la défaite de Sicile ; et il pouvait bien effectivement y avoir eu quelque traité de paix entre l'an 3560 et l'an 3562 que les Athéniens gagnèrent une victoire contre les Lacédémoniens à Cyzique et tuèrent leur général Mindare. Il semble que cette pièce ait été faite exprès pour montrer ce que peuvent les femmes auprès des hommes par l'impossibilité où ils sont de se passer de ces animaux-là (pour parler comme un Comique de nos jours). Sur ce point là on ne doit pas s'attendre à trouver rien qui ne soit dans les règles de la plus sévère pudeur et de la plus austère vertu.
Ceux qui

13
pré[?]face►
Ceux qui se sont donné la peine jusqu'ici de commenter Aristophane ont prétendu que Les Grenouilles avaient été faites après la mort de Socrate pour venger le poëte de ce qu'Euripide, sensiblement touché par cette mort, avait eu intention dans son Palamède d'en rejeter la haine sur les cruelles railleries d'Aristophane dans les Secondes Nuées. Sans ce que nous avons dit ci-dessus pour faire voir la fausseté de l'influence que l'on veut que les Nuées d'Aristophane aient sur la mort de Socrate, il est bon de remarquer ici qu'Euripide est mort six ans avant Socrate. Ainsi il n'a eu garde de penser à venger par des traits de plume la mort d'un homme qu'il a laissé au monde plein de vie. Cette pièce au reste est une critique d'Euripide, mais une critique satyrique et mordante, dont le but, après beaucoup de railleries, est de faire voir qu'il est en-dessous d'Eschyle, un des premiers en date, à la vérité, mais le plus chétif de tous les poëtes tragiques anciens dont les ouvrages aient passé à postérité. Qu'on eût préféré Sophocle à Euripide, bien des gens seront sans doute du goût d'Aristophane ; mais préférer Eschyle à Euripide, il fallait haïr celui-ci autant que le

14
pré[?]face►
que le haïssait Aristophane, - pour lui faire une pareille injure.
Il y a dans cette pièce plusieurs caractères chronologiques qui marquent tous
l'année 3566. La mort d'Euripide, la
mort de Sophocle, la bataille d'Arginuse, tout cela arrivé en l'an 3566. Il y est
encore parlé d'Alcibiade haï et souhaité
par la république. Sur quoi il est à remarquer qu'il
revient à Athènes l'an 3565, qu’il fut exilé la même année, et qu'il fut
tué par Pharnabaze l'an
3568. Le chœur dit dans un endroit : c'est folie de s'amuser à jaser avec
Socrate.Socrate n'était donc pas encore mort quand
on représenta cette pièce ; et en effet il ne mourut que l'an du monde
3572. Le spectacle qui se présente à l'ouverture de cette pièce est
quelque chose de si extravagant et de si fou, que ceux qui ne parlent des anciens
qu'avec une admivénération qui approche de l'idolâtrie, ont sujet d'être
scandalisés d'une pareille pantalonnade. La pièce est plus burlesque qu'elle n'est
sérieuse, quoiqu'il paraisse qu'il s'y agit d'un examen très sérieux. L'auteur y
traite fort cavalièrement Bacchus, Hercule, et Éaque comme il a traité ailleurs Minerveercure et Neptune.
Il semble n'avoir épargné que Minerve,
Cérèset sa fille.
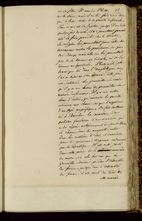
15
pré[?]face►
et sa fille. Il met ici Pluton sur la scène,
mais il ne lui fait rien dire qui le fasse sortir de sa gravité infernale. Pour ce
qui est de Jupiter, quoiqu'il en dise
quelquefois du mal, il n'a pourtant jamais osé le faire paraître sur le théâtre. Sa
religion lui permettait peut-être de murmurer du mal contre la providence du père
des Dieux ; mais elle ne lui permettait pas de le tourner en ridicule, ni de le
donner en spectacle. Plaute a été plus hardi que lui dans
l'Amphitryon, et l'on a sujet de s'en étonner. Cette
pièce est intitulée les Grenouilles, à cause qu'il y a un
chœur de grenouilles des marais infernaux. Il y a un
autre chœur d'initiés, qui conserve la
gravité ordinaire au chœur, et qui s'exprime
d'un style magnifique. On fait soutenir ici à Bacchus le caractère d'un polisson fanfaron d'une manière qui a dû
réjouir entièrement les spectateurs. Le chœur, dans ses
anapestes, entre dans les matières d'état, et intercède pour les généraux d'Arginuse condamnés par la république. Il est aussi parlé dans cette pièce de la monnaie de cuivre, et cela fait voir que
les Grenouilles doivent précéder l'Assemblée des femmes, puisque dans l'Assemblée des
femmes, il est parlé du décri de cette
monnaie

16
pré[?]face►
cette monnaie de cuivre. On ne sait ce que c'est que le chœur qui parle de la dispute d'Eschyle et d'Euripide ; ce ne sont plus ni les grenouilles, ni les initiés, il semble qu'Aristophane s'est oublié ici.
Le changement qu'apporte dans l'état la prise d'Athènes par Lysandre en 3568, et l'établissement des trente tyrans, donna lieu à notre poëte de faire la comédie qui porte pour titre l'Assemblée des femmes, où il suppose que pour sauver l'état, elles renversent l'ordre établi en se rendant maîtresses de tout, ce qui met la république dans une situation beaucoup plus heureuse qu'elle ne l'était auparavant. C'est ainsi que le poète trouvait toujours moyen d'amuser le peuple dans les plus tristes situations où il se trouvait. Praxagore, qui est le principal personnage, dit dans un endroit que l'on avait résolu de faire une alliance avec les voisins ; mais que quand elle eut été faite, on s'en repentit, et l'on exila le rhéteur qui l'avait conseillée. Les scholies disent que c'était une alliance faite deux ans auparavant avec les Lacédémoniens et les Béotiens, et que ce rhéteur

17
pré[?]face►
rhéteur était Conon. Si c'est le fameux Conon, il ne fut parlé de lui qu'après la prise d'Athènes par Lysandre, et Conon gagna une bataille navale à Cnide contre les Lacédémoniens en 3477. Il se peut bien que ce soit du grand Conon que parle Praxagore ; car elle ajoute incontinent : le salut s'est montré ; mais Thrasybule a pris soin de la chasser. Or Thrasybule vivait en même temps que Conon. Et ce fut lui qui délivra la république des trente tyrans en l'an 3570. Il est parlé dans cette pièce du beau Nicias, comme vivant encore dans la mémoire des hommes. Nicias était mort en 3559, et onze ou douze ans après sa mort on pouvait avoir des idées assez vives de sa beauté. Il est aussi fait mention dans cette comédie de la révocation du décret qui avait donné cours aux monnaies de cuivre. Or comme il est parlé de ces monnaies de mauvais aloi dans les Grenouilles représentées l'an 3566, il est évident que l'Assemblée des femmes doit avoir été représentée quelques années après les Grenouilles. Il est aussi fait mention dans cette comédie, comme d'une chose passée depuis quelques années, du décret qui quarantième denier rétabli

18
pré[?]face►
rétabli sur l'avis d'Euripide qui en avait fait l'ouverture. Si c'est Euripide le poëte, il faut se souvenir qu'on a marqué sa mort en 3566. A l'occasion du décret fait par Praxagore, qu'on ne pourra se satisfaire avec une jeune et belle femme qu'après avoir rendu des devoirs forcés à quelque vieille laide, il y a un jeu de théâtre et des discours où règne la licence. À cela près, cette comédie n'est pas une de celles où il y ait le moins d'esprit et de conduite. Elle fut représentée l'hiver.
La dernière des pièces d’Aristophane, dans l’ordre des temps, mais peut-être la première pour le mérite, est Plutus. Il y est parlé, comme d’une chose assez récente, de l’amnistie générale accordée après la défaite des Lacédémoniens à Phyle par Thrasybule ; ce qui arriva en l’an 3570, qui est la même année que Thrasybule chassa les trente tyrans. Il y est aussi fait mention de Denys le tyran, comme vivant et régnant à Syracuse. On sait que ce prince y usurpa la souveraineté l’an 3566, et qu’il ne mourut qu’en 3604. Cette pièce est la plus châtiée de toutes celles d’Aristophane, et commença à sortir du caractère de l’ancienne comédie, qui est de parler trop aux spectateurs.
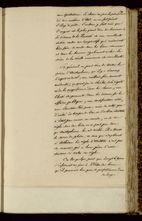
19
pré[?]face►
aux spectateurs. Le chœur ne parle point ici des matières d’état, et ne fait point l’éloge du poëte. L’auteur y fait voir que l’argent est le plus grand dieu des hommes. Le discours de la Pauvreté est une excellente satire contre ces imaginatifs qui croiraient bien faire de rendre tous les biens communs et tous les hommes également riches. La scène de la vieille amoureuse est excellente.
En général on peut dire de toutes les pièces d’Aristophane, qu’il y a beaucoup d’esprit et de sel ; une raillerie fine, souvent mordante ; un grand jeu de théâtre, de la dignité et de la magnificence dans les chœurs ; une liberté surprenante dans les discours sur les affaires publiques ; une versification aisée, une élocution très pure ; mais du reste peu d’unité de lieu, de temps, et d’action. Aristote n’était pas encore au monde ; et si ses règles sont des lois, on ne peut pas dire qu’Aristophane les ait violées. Il a trouvé le secret de plaire ; et ceux qui adoptèrent à2Athènes les règles d’Aristote n’ont pas su mauvais gré à leurs pères d’avoir souvent ri contre ces règles.
On lit quelque part que Denys le tyran s’informait un jour à Platon des livres qu’il pourrait lire pour se perfectionner dans sa langue

sa langue et s’instruire pleinement des mœurs du peuple de la Grèce qui parlait le mieux et qui avait le plus de réputation ; et que ce philosophe équitable et désintéressé lui conseilla de s’attacher aux comédies d’Aristophane où il trouverait la pureté du langage et cette connaissance parfaite qu’il voulait avoir des mœurs des Athéniens. Cela nous donne lieu de rapporter ici une partie de ce qu’Aristophane nous apprend, tant des mœurs en général que du caractère des poëtes anciens et nouveaux et de beaucoup de personnes de son temps. Commençons par la religion.
La divinité la plus représentée à Athènes était Minerve. La ville s’estimait heureuse d’être sous la protection de cette vierge guerrière, et de garder le voile sur lequel était représentée en broderie la victoire qu’elle avait remportée sur le géant Encelade. On le portait en procession tous les quatre ans du Céramique à Eleusine. C’était comme une visite que Minerve rendait à Cérès et à sa fille. On se faisait un très grand scrupule d’entrer dans le temple de cette chaste déesse après avoir vaqué au jeu de l’amour. Il fallait jurer que l’on était pur, et pour ne pas jurer à faux, on avait soin de se laver quand on s’était souillé par l’usage de quelque plaisir, légitime ou non. Au mois de Scirophorion, (c’est celui de Mai)
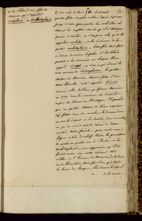
21
* On célébrait une fête de Minerve, qui s'appelait Corbephoria(e)[?] ou Arrhetophoria.►
pré[?]face►
(c'est celui de Mai). * On choisissait quatre filles des plus nobles, depuis sept ans jusqu'à onze, pour les corbeilles où étaient les mystères secrets qu'il n'était pas permis de révéler, et c'est pour cela qu'on les appelait arrhètes, et la cérémonie de les porter arrhétophoria. Cette fête était fixée au douze du mois. Le prêtre d'Erechthée portait à la cérémonie un chapeau blanc appelé Scirros, et c'est ce qui a donné le nom au moins de Scirrophorion. Les petites statues de Minerve étaient aussi faites d'une terre blanche appelée Scirros, comme celles de Vénus qui furent trouvées en 1709 dans les masures de Corseult auprès de Dinan en Bretagne. Il paraît que ces petites statues de Vénus avaient été faites dans des moules, le devant dans un moule à part et le derrière dans un autre, et qu'on avait ensuite réuni ces deux moitiés toutes fraîches pour avoir une figure entière de relief. Outre la procession de quatre en quatre ans à Eleusine et les arrhétéphories, nous apprenons qu'il se faisait encore une cérémonie très célèbre en l'honneur de Minerve, de Vulcain et de Prométhée, trois fois l'an, qui était la course des Lampes. Pour donner le signal de la course
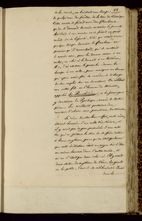
22
pré[?]face►
de la course, on baissait une lampe de quelqu'une des fenêtres de la tour du Céramique. Cette course se faisait avec des flambeaux qu'on se donnait de main en main. La jeunesse brillait à ces courses et se faisait un grand mérite de sa légèreté. Celui qui avait couru quelque temps donnait le flambeau au premier qu'il rencontrait, qui se mettait à courir avec, pour le remettre encore à un autre, et celui-ci le donnait à un troisième, &c, d'où est venu le proverbe : donner la lampe à un autre, pour marquer un homme qui, après avoir fini sa carrière, se décharge de son emploi sur un successeur. On célébrait une autre fête en l'honneur de Minerve, appelée les Panathénées ; et les jeunes gens y dansaient la Pyrrhique, armés de toutes pièces. Les vieillards portaient des rameaux d'olivier aux processions de Minerve.
La reine des sombres enfers, et sa mère, étaient honorées d'un culte très sérieux, et il y avait peu de gens persuadés d'une autre vie qui ne prissent le soin de se faire initier à leurs mystères, parce qu'on y était prévenu que cette initiation était un moyen sûr d'être au moins heureux dans l'autre monde, si on ne l'était pas dans celui-ci. Il y avait deux sortes de mystères de Cérès, les grands et les petits. Ceux-ci se célébraient à Eleusisdans le

23
pré[?]face►
dans le voisinage d'Athènes. Ceux qui se faisaient initier, tant aux grands qu'aux petits, portaient l'habit qu'ils avaient à cette cérémonie jusqu'à ce qu'il fût usé ; après quoi, quand il montrait la corde et commençait à tomber en lambeaux, on le pendait au râtelier de la déesse. Quand on partait d'Athènes pour aller à Eleusis s'enrôler dans cette célèbre confrairie, tout l'équipage des mystères était porté par des ânes. On célébrait à Athènes trois fêtes de Cérès : Démétria, Thesmophoria et Eleusinia. Les femmes seules célébraient les Thesmophories, qui était comme la fête de l'institution des lois. On y jeûnait rigoureusement, mais les bonnes dames, en récompense, y buvaient copieusement. Les Thesmophories duraient cinq jours. Les tribunaux étaient fermés, et le conseil ne se tenait point. Le signal de la fête des Thesmophories et de l'assemblée ou de la procession des femmes, était une sorte d’étendard que l'on mettait sur le temple de Cérès. On allumait beaucoup de lampes. Chaque femme avait une suivante garnie d'une corbeille où était le gâteau que la maîtresse offrait aux Déesses. On chantait le cantique lubrique de l'Ithyphalle ou représentation du membre viril. Les esclaves n'assistaient point au secret des mystères, qui se développaient dans un bois sacré. Les porteuses de corbeilles

de corbeilles mystiques, à la fête de Cérès, avaient à leur suite des filles couvertes et cachées d'un grand voile, qui leur portaient un tabouret. On sacrifiait des cochons à Cérès, de même qu'à Bacchus, parce que cet animal vorace fait le dégât dans les moissons aussi bien que dans les vignes.
Diane la chasseresse avait aussi ses fêtes à Athènes. Une des principales était celle qu'on appelait Brauronia. Des filles de dix ans, vêtues de jaune, en faisaient l'office ; et l'on appelait cela faire les ourses, à cause que cette fête avait été instituée par réparation de la mort d'une ourse consacrée à Diane, qui avait été tuée par les habitants de la tribu Flanis.
Il ne faut pas finir l'article des Dieux femelles sans parler d'Hécate et des Euménides. Il fallait donner un repas une fois le mois à Hécate, et ceux qui n'avaient pas le moyen de leur donner à leurs frais, étaient autorisés par la religion à dérober plutôt que de manquer à un devoir aussi essentiel que celui-là. Pour ce qui est des Euménides, c'étaient mesdames les Furies, à qui l'on donnait ce nom flatteur, de peur de les offenser en les appelant par leur nom. Car Euménides, c'est, comme qui dirait, favorables. On les
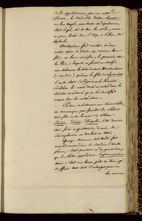
25
pré[?]face►
On les appelait encore, par une autre flatterie, les Vénérables Déesses, Semnx ; et leur temple, avec toutes ses dépendances, était le plus sûr de tous les asiles, comme on peut le voir dans l'Edipe à Colone, de Sophocle.
Aristophane fait mention de deux autres espèces de déesses qui avaient leurs fêtes et leurs sacrifices ; la première est la Paix, à qui l’on faisait un sacrifice non seulement le Seize du mois Hecatombeion (c'est Juin) pendant les fêtes des Synœcèses. L'autre était Calligénie, ou la Fécondité. Erichthon lui avait dressé un autel dans dans la citadelle et ordonné qu'on lui sacrifiât avant tous les autres dieux.
Passons maintenant aux Dieux mâles, et commençons par Jupiter. On célébrait trois fêtes en son honneur à Athènes : Pandia, Diasia, Diipolia. Cette dernière était fixée au quatrième du mois de Scirrophorion et tombait en Mai.
Quoique Mercure soit traité fort cavalièrement dans les comédies d'Aristophane, c'était pourtant un des grands dieux que les Latins appelaient majorum gentium. Mais c'était une bonne pâte de Dieu, qui souffrait toute sorte d'outrages pour un bon morceau
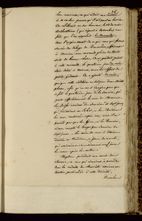
26
pré[?]face►
bon morceau, et qui aidait aux larrons à se cacher pourvu qu'il ait part au larcin. On célébrait en son honneur, le 13 du mois Anthesthérion (qui répond à Novembre), une fête que l'on appelait les Marmites, dont l'origine venait de ce que ceux qui furent sauvés du déluge de Deucalion, offrirent à Mercure une marmite remplie de toute sorte de bonnes choses. On ne goûtait point à cette marmite. Le quatrième jour du mois était dédié à Mercure, et on lui offrait de petits gâteaux. On a ajouté : du mois, quoique cette addition ne soit pas dans Aristophane, afin que l'on ne s’imagine pas que ce fût le quatrième jour de la semaine, qui porte effectivement le nom de Mercure. Les Juifs avaient des semaines de sept jours, qui finissaient au Sabat, et les Chrétiens les ont conservées après eux ; mais il ne paraît pas que les Grecs, ni les Romains, aient compté le temps par semaine de sept jours. Les mois de ceux-ci étaient divisés en Nundines, ou jours de marché, qui arrivaient successivement neuf jours les unes après les autres.
Neptune présidait aux courses des chevaux, et ceux qui aimaient à paraître dans la conduite des charriots avaient une dévotion particulière à cette divinité.

Bacchus avait plusieurs fêtes. Les deux
principales se célébraient, l'une au printemps, dans la ville, et c'était le temps
que l'on apportait les rentes aux bourgeois. L'autre se célébrait l'hiver, aux
champs, et s'appelait la fête du
pressoir. Il n'y avait point d'étrangers à celle-ci. Au mois de Pyanepsion,
qui est en octobre, ou selon d'autres, au mois d'Anthesthérion, qui est Novembre,
on
célébrait en l'honneur de Bacchus une
autre fête qui fut appelée Coès, ou des Gobelets, à cette occasion. Oreste étant venu à Athènes
pendant qu'on célébrait cette fête, en se trouvant excommunié à cause du meurtre de
sa mère, persuada à ceux qui assistaient au festin, de verser du vin, chacun dans
sa
coupe, sans la donner à son voisin, et établit des prix pour ceux qui la videraient
les premiers et de meilleure grâce. De cette sorte il put boire tout à son aise,
sans se ressentir des effets de l'état d'excommunication où il était, et sans en
donner de connaissance aux autres.
Depuis, on vuidait les gobelets au son de la trompette, et le premier qui avait faitfiniavaitrecevait pour récompense un outre plein de
vent. Les anciens ne buvaient pas comme nous, en portant la coupe ou le gobelet sur
les lèvres, mais en versant de haut dans la bouche

bouche ouverte ; en quoi il fallait de l'adresse pour expédier proprement et promptement un gobelet. Les anciennes peintures et sculptures qui nous apprennent cette façon de boire nous apprennent aussi que ces gobelets étaient comme des petits pots sans anse, à la façon de nos carafes de soucoupe. [ Il y avait aussi une autre fête de Bacchus à Athènes, qui s'appelait les Marmites. On lui sacrifiait des cochons, pour la même raison qu'on en sacrifiait aussi à Cérès. Les fêtes de Bacchus, du moins les deux principales, étaient accompagnés de jeux publics, de spectacles, de combats de musique, de danse, &c. Les cérémonies de sacrifices de Bacchus sont représentées dans les Acarniens d'Aristophane. Premièrement marche une fille, avec une corbeille remplie de prémices, et après elle marche une esclave qui porte l'Ithyphalle. La corbeille se met à terre, et l'on en ôte les prémices pour en faire l'offrande qui se fait en versant de la purée sur un gâteau que l'on présente respectueusement au fils de Sémèle. Cela suppose, et la supposition est vraie, que l'on portait aussi une marmite pleine de purée. La fille et l'esclave sont suivis d'un vieillard qui chante un hymne à l'honneur de l'Ithyphalle. La raison pourquoi on portait l'Ithyphalle à ces mystères, est la même

29
pré[?]face►
la même à peu près, pourquoi ceux d'Azot, en renvoyant l'arche de Dieu, y mirent des culs d'or. On s'était moqué des mystères de Bacchus la première fois qu'ils étaient apparus à Athènes, où Pégase les avait apportés d'Eleuthère en Béotie. En punition, il vint du mal aux parties naturelles des hommes, et peut-être même à celles des femmes, car les femmes ne sont pas moins railleuses que les hommes, quand elles s'y mettent. On établit donc, en réparation d'une si grande faute, une coutume de porter en procession la figure de la partie par laquelle les hommes avaient été punis. On s'imaginera peut-être que dans les corbeilles mystérieuses, il y avait aussi la représentation du bon ami de l'Ithyphalle. Il n'y a point de péché à croire, non plus qu'à se persuader qu'il pouvait y avoir quelque chose de semblable dans les corbeilles qui se portaient aux mystères si secrets de la mère de Proserpine. Et la raison de cette représentation pouvait être fondée sur ce qui était arrivé à cette bonne mère, lorsqu’elle cherchait sa fille perdue. N'en pouvant plus de tristesse et de lassitude, elle s'arrêta quelque part, où une vieille femme n'ayant pu la mettre de bonne humeur en lui donnant à boire, s'avisa, pour la faire rire, de lever

30
pré[?]face►
de lever sa cotte le plus haut qu'elle put, et de montrer quelque chose qui fit enfin sourire la bonne déesse. Dans les fêtes de Bacchus, c'étaient les premières filles de la ville qui portaient les prémices dans des corbeilles d'or. On ne parle point ici du reste du sacrifice ; on le dira en parlant des sacrifices en général.
On prétendait qu'Esculape faisait de grandes et merveilleuses guérisons dans l'île d'Egine. On y portait les malades, et on leur faisait passer la nuit dans son temple. On les lavait d'abord à la mer, ensuite on sacrifiait des gâteaux, des figues, d'autres bagatelles. On se couchait après cela dans le temple, chacun à part sur sa natte, et l'on s'enveloppait de sa couverture. Quand tous les malades et leur compagnie étaient en train de se reposer, le prêtre venait éteindre la lampe, recueillir les offrandes et ramasser ce qui n'avait pas été brûlé. Après cela, Esculape faisait son devoir ou ne le faisait pas.
Outre les fêtes des Dieux, il y en avait aussi d'établies pour honorer la mémoire des hommes. Il est parlé d'une fête de Thésée, où l'on faisait largesse au peuple, et cette largesse consistait en purées, bouillies et autres libéralités de cette
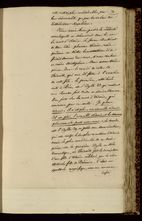
31
pré[?]face►
cette nature, plus considérables par leur universalité que par la valeur des distributions singulières.
Vénus avait bonne part à la célébrité avec laquelle on solennisait tous les ans la mort d'Adonis. Les femmes chantaient de tous côtés : pleurons Adonis ; mais pendant ces tristes lamentations il se faisait souvent des cocus, si nous voulons en croire Aristophane. Nous avons trois pièces, dans le recueil de celles de Théocrite, qui ont été faites à l'occasion de cette fête. La première, attribuée aussi à Bion, est l'idylle 23, qui contient une chanson fort tendre et admirablement bien faite sur la mort d'Adonis, qui commence par ces mots : Je pleure Adonis ; il n'est plus, cet admirable Adonis. Il est péri, l'aimable Adonis, et les Amours pleurent sa perte avec nous. La seconde est l'idylle 29, en petits vers Anacréontins, qui est contre le sanglier meurtrier d'Adonis. Mais la plus considérable de ces trois pièces est la quinzième Idylle en stile dramatique, où Théocrite fait la description d'une fête d'Adonis célébrée par la reine Arsinoé, fille de Bérénice. C'était un spectacle magnifique, avec un concours infini
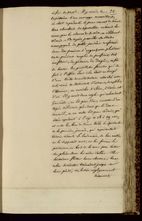
32
pré[?]face►
infini de peuple. Il y avait des tapisseries d'un ouvrage merveilleux, où était représenté le jeune amant de Vénus. Une chanteuse de réputation enlevait les cœurs par le charme de sa voix, en célébrant Adonis. On voyait paraître sa statue entourée de petits jardins renfermés dans des paniers d'argent, avec plusieurs vases précieux remplis de parfums ; des confitures, des gâteaux, des dragées, enfin de toutes les gentillesses friandes qui se font à l'office. Tout cela était ombragé d'une treille de molle verdure attachée avec art, ornée de toute sorte d'oiseaux, de reptiles, d'Amours, et enrichie d'ébène, d'ivoire et d'or. Il y avait deux aigles qui enlevaient Ganymède ; un lit pour Vénus, couvert d'un tapis délicieux plus doux que le doux sommeil, et un autre lit pour Adonis, qui était représenté à l'âge de 18 à 19 ans, et entre les bras de Vénus. Voilà le spectacle de la première journée, qui représentait Adonis vivant. Le lendemain, de bon matin, on le supposait mort, et les femmes le portaient au bord de la mer pour laver ses plaies dans les ondes salées. Elles laissaient flotter leurs cheveux ; leurs robes desceintes traînaient jusque sur leurs pieds ; et, le sein négligemment découvert,

33
pré[?]face►
découvert, elles entonnaient de tristes plaintes. La pièce mériterait d'être insérée ici toute entière, si nous ne nous faisions pas un scrupule de mêler un poëte fort tendre avec un poëte qui a bien eu le cœur de faire quinze comédies sans y mêler un seul brin d'amour et de mariage. Nos poëtes modernes sont bien plus galants ; ils ont mis de l'amour et du mariage partout, jusque dans les tragédies les plus funestes, comme si l'amour était toujours de moitié dans toutes les actions qui méritent d'être mises sur le théâtre.
Revenons aux Dieux, après cette courte digression, qui était nécessaire, et qui ne nous a pas menés fort loin. Il nous reste à faire quelques observations générales.
Pour adorer et remercier les Dieux, on commençait par baiser la terre. Il y en a un exemple dans les Chevaliers d'Aristophane. Latone est parfois surnommée par épithète : aux yeux d'or, et Minerveaux yeux bleus. L'or est une belle couleur ; mais quelque précieuse qu'elle soit, il n'y a personne sans doute, qui ne préférât les yeux de Minerve à ceux de Latone. Il y avait par tout beaucoup d'images des Dieux peintes

peintes sur des planches de bois. Jupiter était représenté avec une aigle sur la tête ; Minerve avec un hibou ; Apollon avec un épervier ; Esculape avec un serpent. C'est comme les chrétiens représentent St Roch avec son chien, St Eustache avec son cerf, St Gilles avec une biche, St Antoine avec un cochon, St Guingaloé2 avec une oie, St Nicolas avec un charnier rempli de trois petits enfants, St Martin avec son cheval, St Jérôme avec un lion, &c. On appelle gloire parmi les chrétiens, ou nimbe parmi les antiquaires3 un certain rondeau que l'on plaçait autrefois sur la tête des statues, et l'on s'imagine que ce rondeau est un apanage de canonisation ou de majesté. Les anciens mettaient un rondeau pareil sur la tête de leurs fausses divinités et l'appelaient petite lune ou ménisque. Mais leur intention, en y plaçant cette ménisque, n'était pas de marquer la béatitude de la personne représentée, ce n'était que pour empêcher que les oiseaux ne gâtassent les statues par ce qu'ils laissent échapper en volant. C’eût été en effet une chose bien scandaleuse et offensive des religieux regards, de voir un Dieu barbouillé d'ordures. C'eût été même une chose horrible à Athènes d'appeler tombeau un autel des Dieux.
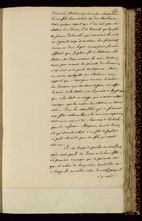
35
pré[?]face►
Dieux. Les Chrétiens ont été moins scrupuleux ; ils ont fait leurs autels sur des tombeaux. Mais quelque respect que l'on eût pour les statues des Dieux, il se trouvait quelquefois de jeunes débauchés qui couraient la nuit, et à grands coups de marteau leur faisaient, comme un Duc bigot2 de nos jours, le même affront que Jupiter fit à Saturne. Ces statues des Dieux avaient la main étendue, comme pour recevoir des présents des hommes, c'est ainsi que parle Aristophane. Mais un ancien apologiste des Chrétiens nous apprend que c'était pour recevoir le salut qui touchaient pour cet effet la main de la statue ; et il y avait si longtemps que cela était en usage, que ce même auteur remarque que les mains des statues en étaient usées. Dans les assemblées qui se faisaient aux fêtes solemnelles, les merciers exposaient tout comme aujourd'hui, beaucoup de babioles pour les enfants. Strepsiade, dans les Nuées, dit qu'il avait acheté à une fête de Jupiter un petit chariot pour son fils qui avait six ans.
Il est temps de parler des sacrifices, après avoir parlé des Dieux et de leurs fêtes. La première remarque qui se présente est que le métier de bouquetière devait être en ce temps-là un métier assez lucratif, puisqu'il n'y avait

36
pré[?]face►
n'y avait guère de jour où il ne fallût des couronnes et des festons. Car non seulement tous ceux qui sacrifiaient ou assistaient au sacrifice devaient être couronnés ; mais la coutume était de se couronner de fleurs dans toutes les débauches, et d'orner par dévotion sa porte de festons de fleurs et de rameaux d'olivier. Ces couronnes, surtout celles que l'on rapportait des sacrifices, étaient des sauve-gardes, et il n'était pas permis de maltraiter une personne couronnée, fût-ce un esclave. Quand on avait grande envie de le battre, on lui ôtait sa couronne, à peu près comme les Moscovites d'aujourd'hui ôtent respectueusement la calotte de leurs papas avant que de les rosser. L'attirail d'immolation était un panier dans lequel était l'orge salée, les bandelettes et le couteau ; du feu, une aiguière ou bénitier rempli d'eau lustrale, un tison que l'on trempait dans cette eau pour faire l'aspersion autour de l'autel et puis sur tous les assistants. On jetait ensuite l'orge salée sur tous ceux qui étaient présents au sacrifice. Après, suivait la prière, qui commençait par ces mots consacrés : Qui sont ceux qui assistent ? à quoi l'on répondait : des gens de bien. Après cette préface, on invoquait le dieu, auquel on sacrifiait, et dans la prière, après avoir parlé

37
pré[?]face►
avoir parlé pour les Athéniens, on ajoutait toujours : et pour ceux de Chio, parce qu'il y avait communion de prière entre les Athéniens et ceux de Chio. Avant cette prière, un héraut criait : paix, attention, silence. On faisait ensuite les libations, et cela fini, on disait : la libation est faite, appelle le Dieu. Bacchus, dans les Grenouilles, fait une sale allusion à ces termes consacrés. Il a lâché une libation dans ses chausses, de peur, et Aristophane lui fait dire : ἐγκέχοδα (au lieu de ἐκκέχυται) κάλει θεόν. J'ai fait dans mes chausses, appelle le Dieu. Il ne restait plus que de couper la gorge de la victime, la dépecer, et en offrir de certains membres. On faisait le feu, on apportait une table pour couper dessus ; on coupait la langue à part, et c'était le morceau du héraut ou crieur. On offrait les entrailles après les avoir fait cuire avec tout le reste ; on offrait aussi les quartiers destinés pour le Dieu ou pour les prêtres, et l'on faisait de nouvelles libations, si l'on aime mieux dire que c'est ici la place de celles dont nous avons déjà parlé. On n'oubliait pas le sel dans les sacrifices, et Moyse avait eu soin d'avertir qu'on se donnât bien de garde d'y manquer dans ceux du vrai Dieu.
Comme on

38
pré[?]face►
Comme on ne brûlait pas tout, il est aisé de juger que le sacrifice était suivi d'un festin où le vin n'était pas épargné. Une des cérémonies les plus essentielles du sacrifice était de manger les entrailles des victimes ; et la plus grande imprécation que l'on pût prononcer contre quelqu'un, était de lui dire : puisses-tu n'avoir jamais part aux entrailles sacrées des victimes ! Messieurs les sacrificateurs étaient des gens bien maussades d'avoir le soin de vuider les tripes de tant de bêtes. Il est remarqué quelque part que l'on sacrifiait une brebis noire pour appaiser la tempête. On immolait un cochon de lait pour l'ouverture de l'assemblée où l'on traitait des affaires publiques. Les athéniens allaient souvent sacrifier à Delphes. Comme il fallait passer par la Béotie pour aller d'Athènes à Delphes, les Athéniens achetaient des Béotiens la liberté du passage. Il était défendu de sacrifier un animal sans queue ; et Moyse, qui avait adopté beaucoup de cérémonies des payens, en avait fait une loi expresse dans son cérémonial. Les mystiques ont trouvé une raison admirable de cette défense. La queue, disent-ils, est le symbole de la persévérance, et l'on ne peut plaire à Dieu si l'on est dans la disposition sincère de persévérer

39
pré[?]face►
persévérer à son service ; découverte admirable ! qui a été adoptée depuis peu par un vénérable cynique encapuchonné qui disait à une jeune Ourseline1 qui s'engageait par des vœux solemnels dans le régiment des onze mille vierges ; "Vous n'êtes encore, ma chère sœur, qu'une petite ourse, une Ourseline, une masse informe ; mais la grande mère Ourse vous léchera tant, qu'elle vous formera les yeux de la pénétration, le nez de la sagacité, les oreilles de l'attention, les joues de la modestie, les épaules de la patience, le mains de l'industrie, les pieds de la promptitude à obéir, et la queue de la persévérance, que je vous souhaite." Mais la véritable raison de la défense d'oublier la queue, c'est qu'en Égypte, en Syrie et ailleurs dans les pays orientaux, la queue du menu bétail est si grasse et si charnue, qu'elle peut passer pour un cinquième quartier de la bête, et c'est le plus délicat de tous.
Si le peuple Athénien était religieux, il était aussi superstitieux à l'excès ; et nous en avons quelques preuves dans Aristophane. Par exemple, quelque affaire qui se proposât dans l'assemblée, et de quelque importance qu'elle fût, l'assemblée se séparait sans rien conclure, s'il tombait seulement une goutte d'eau. Le peuple donnait

40
pré[?]face►
donnait beaucoup de crédit aux oracles des Sibylles, et l'on profitait de son faible
là dessus pour le mener par le nez. Un tremblement de terre, un feu follet, un chat
qui traversait le chemin ; tout cela était regardé comme de mauvais augures présages, capables
d'interrompre l'entreprise la plus sérieuse. Les festons sacrés dont on ornait les
portes par dévotion sont encore une preuve de la crainte superstitieuse du peuple,
qui s'imaginait par ce moyen pouvoir détourner le malheur dont il était menacé. Ces
festons s'appelaient Tiresiones.
C'étaient des rameaux d'olivier entortillés de laine, où l'on attachait des fleurs
et des fruits. Les athéniens croyaient que la vue du loriot donnait la jaunisse ;
c'est pourquoi on le vendait couvert. Comme le hibou était l'oiseau consacré à Minerve, on laissait vivre les hiboux en
paix à Athènes : De là venait que l'on n'y voyait autre
chose que des hiboux.
On n'a point prétendu faire ici une dissertation savante sur la religion des Athéniens, mais l'on s'est borné à dire ce qui s'en trouve dans Aristophane. Ainsi le lecteur doit se contenter du peu que nous en avons rapporté. Nous allons passer aux mœurs, dans le même plan, c'est à dire en nous renfermant dans notre auteur.
La ville

41
pré[?]face►
La ville d'Athènes, si fameuse dans l'histoire, contenait environ trente mille hommes, selon la supputation d'Aristophane. La république athénienne était un état populaire et extrêmement jaloux de sa liberté. Nous y connaissons quatre Cours principales. La première jugeait les crimes capitaux ; c'étaient les Aréopagites. La seconde connaissait des causes civiles. D'abord elle était de cinquante juges, mais elle fut depuis réduite à dix, qui étaient tirés au sort par dix billets marqués A, B, &c. Celui qui tirait A était archonte. Quand tous avaient tiré (et il est à croire qu'il y avait beaucoup plus de billets blancs que de noirs), le héraut donnait à chacun des dix une baguette en signe de juridiction. Aristophane a fait allusion à cette coutume dans le Plutus et dans l'Assemblée des femmes. Outre cela il y avait encore la grande assemblée appelée Pnyx, et la petite, appelée le Conseil. On appelait du Conseil à la grande assemblée du peuple qui était véritablement celle où résidait l'autorité souveraine. Mais le respect que cette autorité lui devait attirer n'a pas empêché Aristophane de nous la représenter composée de gens qu'on menait par le nez comme on voulait. Au milieu

Au milieu de la délibération la plus sérieuse, un étourdi venait dire que les chevrettes et les merlans étaient à bon marché. Aussitôt on ne parlait plus d'autre chose ; on fermait l'oreille aux Rhéteurs, on couronnait celui qui avait apporté la bonne et heureuse nouvelle, et l'assemblée se dissipait. Les Prytanes, placés sur une tribune de pierre, à l'air et sans toit, présidaient à l'assemblée qui se tenait aussi à l'air sur des sièges de pierre ; et ceux qui fréquentaient cette assemblée étaient appelés Héliastes, par dérision, à cause que n'étant couverts d'aucun toit, le soleil (Ἥλιος) leur faisait souvent bouillir la cervelle. Les Prytanes indiquaient l'assemblée, et l'on s'y rendait le matin de très bonne heure. Un homme tenait une corde rougie d'ocre, et en frappait tous ceux qu'il rencontrait. Ceux qui se trouvaient marqués et ne se rendaient pas à l'assemblée, payaient l'amende. Chaque particulier qui entrait à l'Assemblée recevait un maireau, et lorsqu'il le rendait à la sortie, on lui donnait trois oboles. L'ouverture de l'assemblée se faisait par l'immolation d'un cochon de lait, du sang duquel on faisait aspersion sur les sièges. Après cela le héraut criait : Qui veut parler ? Celui qui voulait haranguer prenait une couronne. Il paraît qu'un seul

43
pré[?]face►
qu'un seul homme qui contredisait un décret proposé pouvait faire rompre la délibération, surtout s'il assurait qu'il fût tombé quelque goutte d'eau sur lui. C'est ainsi que dans les AcarniensDicéopolis fait dissoudre l'assemblée. Ceux qui la composaient avaient chacun un bâton, une casaque, des socques. Dans la place où se tenait l'assemblée était une statue de Lycus, ancien héros, entourée d'une clôture de cannes de roseaux. Là se tenaient les dix Sycophantes ou dénonciateurs en titre d'office. Là se distribuait le triobole aux membres de l'assemblée. Là se tenaient aussi les condamnés ; et là enfin pissaient assez souvent messieurs les juges. Cette grande assemblée était composée ordinairement d'environ six mille têtes. Quelle cohue ! Il y avait des balustres à l'auditoire, apparemment autour de la tribune du Prytane, et le bonhomme Philocléon, dans les Guêpes, prétendait que, point de balustres, point de jugement. Un meuble nécessaire à l'audience était une horloge à l'eau pour mesurer le tems1 aux orateurs. Avant l'audience, on faisait un sacrifice de quelques grains d'encens, accompagné de quelques prières précédées du cri ordinaire : Eufémia ou Fémen agathon, c'est à dire : Silence. Le harangueur

44
pré[?]face►
harangueur qui prenait la parole se couronnait d'une couronne de myrthe. Au sortir de l'assemblée le triobole était payé par celui des Thesmothètes qui était en fonction, qui reprenait les maireaux et donnait les oboles à chacun de ceux qui avaient assisté à l'assemblée, ou une draqme à partager entre deux ; car la draqme valait six oboles. Les délibérations publiques s'écrivaient dans un tableau qui demeurait exposé, afin que personne n'en prétendît cause d'ignorance. Ceux qui faisaient trop de bruit et de fracas dans l'assemblée étaient enlevés par les archers au moindre signe des Prytanes. On haussait la main pour marquer son consentement à ce qui était proposé. Cela s'appelait Chirotonia, terme que les chrétiens ont adopté pour marquer l'institution de leurs magistrats spirituels, qui se faisait autrefois par la seule imposition des mains. Et c'est aussi de là sans doute qu'est venue notre manière de parler, pour marquer que l'on consent à quelque chose, de dire : j'y donne les mains.
La principale magistrature était celle de l'archonte, qui n'était en exercice qu'un an, et l'année portait son nom, comme à Rome on comptait les années par les Consuls.

45
pré[?]face►
par les Consuls. L'archonte se couronnait de branches de myrte dans les actions publiques. Il n'était pas permis aux comédiens satyiriques de nommer les archontes dans leurs satires. Il éludaient la défense et les nommaient hardiment au moyen d'un petit changement qu'ils faisaient à leur nom, ou en leur donnant un autre père que le leur. C'est ainsi qu'Aristophane voulant lâcher quelques traits contre Amynias, fils de Pronape, l'appelle Amynias, fils de Sellus. Après les archontes, venaient les Prytanes qui étaient les modérateurs de l'assemblée. Il paraît que les Prytanes avaient part au maniement des finances, et qu'ils étaient logés dans un palais commun, appelé pour cela le Prytanée. Les particuliers qui s'étaient distingués par quelque service rendu à l'état, étaient nourris à ce Prytanée aux dépens du public. On accordait même cette grâce aux poëtes fameux, et Aristophane se moque de quelques faiseurs de Dithyrambes ou Odes Bachiques, à qui on avait prodigué cet honneur.
Les trésoriers de l'état avaient, pour marque de leur emploi, un anneau qui leur était donné par le peuple.
Les magistrats publics portaient une couronne

46
pré[?]face►
couronne sur la tête, et on la leur ôtait en les destituant.
Les Agoranomes étaient des juges de police qui mettaient le prix aux denrées, et avaient soin que tout se passât en ordre au marché.
Les juges criminels qui voulaient marquer qu'ils condamnaient quelqu'un, traçaient sur leurs tablettes une grande ligne. Ils procédaient aussi par voies de ballottes (de même que dans la grande assemblée). On jetait ces ballottes dans des urnes dont le haut était fait en entonnoir. Après cela, on renversait ces urnes sur une table de pierre pour voir l'issue des jugements. Il y avait deux urnes ou boîtes, la première s'appelait κύριος ou la principale. Elle servait pour absoudre, et l'on y mettait des ballottes solides. La seconde était nommée ἄκυρος ou ὕστερος, c'est à dire, la dernière ou la plus faible, et l'on y mettait les ballottes percées qui servaient à condamner.
Il y avait à Athènes un collège de onze juges qui expédiaient les voleurs et les homicides pris sur le fait. Ceux qui ne confessaient pas leurs crimes, on les menait devant les juges ordinaires.
Le Démarque était un officier public qui gardait les minutes des contrats.
Il y avait des intendants annuels qui avaient la direction des mystères et des cérémonies

47
pré[?]face►
cérémonies de la religion. On les appelait Epoptes ou inspecteurs.
Il y avait dix magistrats annuels, qui étaient comme des avocats généraux, qui recevaient par jour chacun une dragme. On appelait ce salaire συνηγορικόν.
Il y avait six Thesmothètes ou Préteurs, qui aidaient aux Prytanes à diriger l'Assemblée, qui payaient les trois oboles à chacun de ceux qui y avaient assisté, et fermaient le chanceau2 à ceux qui étaient les derniers à s'y rendre.
Le peuple d'Athènes était divisé en quatre classes. La première était des plus riches appelés πεντακοσιομέδιμνοι ou Cinq cents boisseaux. La seconde comprenait les Chevaliers, gens d'une fortune moins brillante, mais qui étaient pourtant à leur aise, et qui vivaient honorablement. La troisième classe comprenait les ζυγῖται, ou gens de joug, c'est-à-dire, les paysans, les laboureurs, les gens moins riches, dont il en fallait, pour ainsi dire, attacher plusieurs ensemble au même joug pour supporter quelque légère charge de l'état. La quatrième classe était la plus misérable, elle ne comprenait que les pauvres et les mendiants onéreux au public. Il y avait, comme on l'a déjà dit, environ trente mille hommes à Athènes ; mais l'état était si puissant que l'on comptait plus de mille

48
pré[?]face►
mille villes qui étaient alliées d'Athènes, ou qui lui payaient tribut. L'Attique avait été divisée par Solon en trois classes : les Paraliens ou ceux des côtes, dont il avait donné la conduite à Mégaclès ; les Pédiéens ou gens du plat pays, qu'il avait mis sous Lycurgue, et les Diacriens. Le trésor de la république était gardé dans la citadelle, dans un endroit appelé ὀπισθόδομος ou l'arrière-maison, et était sous la garde de Minerve protectrice de la république et en particulier de la ville.
On donnait à Athènes une fort belle éducation à la jeunesse, et l'on prenait un soin extrême de lui former l'esprit par l'étude des belles-lettres, et le corps par des exercices, la lutte, la course, la danse, la musique. L'ancienne manière d'élever frugalement et modestement la jeunesse est admirablement bien décrite dans les Nuées. Un homme qui n'aurait pas su la musique serait passé pour n'avoir point eu d'éducation. On exposait dans des pots de terre les enfants que l'on ne voulait pas se donner la peine d'élever, afin que ceux qui les voudraient prendre pussent facilement les emporter. Ce pot s'appelait κάνθαρος, et nous dirons en passant que de ce κάνθαρος on a fait une Canthara, c'est à dire, qu'on a changé

a changé un pot en une femme, dans la scène 4 du quatrième acte de l'Andrienne de Térence.
Quand les enfants avaient atteint l'âge de quinze ans, on les présentait au temple à la fête des Apaturies, en disant au ministre des Dieux : je vous présente un enfant mâle (ou femelle) citoyen d'Athènes. Ces vénérables ministres avaient droit de les tâter pour voir si on ne les trompait point sur le sexe. Ensuite on les pesait et on les mesurait. Cela se faisait par un officier public appelé Meïgagogue, parce qu'il devait trouver l'enfant au-dessous du poids et de la mesure prescrite, et prononcer μεῖον , μεῖον, c'est à dire, moindre. Le troisième jour de la fête des Apaturies s'appelait κουρεῶτις, c'est-à-dire, le jour de l'épreuve des jeunes gens. Les pères et les mères présentaient leurs enfants à des juges préposés pour cela, et disaient : nous vous présentons un vrai citoyen d'Athènes de l'âge de quinze ans, né d'une citoyenne d'Athènes. Les juges, pour s'assurer si les enfants pouvaient avoir leur âge, leur passaient la main sous la robe, et tâtaient s'ils avaient les marques naturelles de puberté et s'ils étaient mâles ou femelles. On faisait encore une autre présentation à dix-huit ans, et alors les enfants étaient décrits au nombre des Ephèbes

50
pré[?]face►
des Ephèbes. Il était nécessaire de s'assurer si les garçons avaient toutes leurs pièces ; car sans cela les sacrifices qu'ils auraient pu offrir dans la suite eussent été nuls. On faisait un festin le dixième jour de la naissance d'un enfant, pour le nommer. Selon les lois de Solon les bâtards n'héritaient point ; et s'il n'y avait point d'enfants légitimes, la succession allait aux parents les plus proches. On donnait seulement aux bâtards, à la main, cinq mines ou mille dragmes, selon Harpocration dans le Lexicon des dix rhéteurs, et on appelait cela le lot du bâtard. On pouvait acquérir le droit de bourgeoisie à Athènes, après y avoir demeuré sept ans. Mais on n'accordait pas toujours cette grâce, et Aristophane en fait un sujet de raillerie contre Archedème, dans les Grenouilles.
Les Athéniens étaient grands amateurs de la nouveauté, et s'éloignaient chaque jour de leurs anciennes pratiques. Aristophane leur reproche encore d'avoir été fort remuants, trompeurs et sans parole. Ils étaient grands raisonneurs et froids dans le vin, au lieu que les Lacédémoniens avaient le vin fort gai. Les Athéniens prenaient souvent des résolutions extravagantes. Pour s'en consoler, ils disaient que c'était le destin de la ville d'en prendre de pareilles, et qu'elles réussissaient cependant toujours, selon la prédiction de Neptune réformée par Minerve

51
pré[?]face►
Minerve, dans leur différend au sujet de la prétention réciproque qu'ils avaient tous deux d'être le patron de cette ville. Minerve l'emporta, et Neptune en colère lui dit : les Athéniens prendront souvent des résolutions extravagantes. Cela se pourra, dit Minerve, mais je ferai en sorte qu'elles tourneront à leur avantage.
Les Athéniens étaient aussi grands chicaneurs et amateurs de procès. Il n'y a qu'à voir là-dessus les Oiseaux et les Guêpes d'Aristophane. C'étaient les hommes qui allaient eux-mêmes au marché, à la poissonnerie, à la boucherie. Nous apprenons du Piovan Arlot que c'était assez la coutume de Florence et de Rome, de son temps ; et l'on dit que cela n'a pas changé depuis.
Il y avait une peste dans la république, qui se fourrait partout et était fort à charge aux honnêtes gens. C'étaient les Sycophantes, ou mouchards et dénonciateurs. Il y en avait dix en titre d'office ; mais une infinité d'autres en faisaient métier, sans être gagés pour cela. Notre auteur les berne dans toutes ses pièces ; mais on a beau maudire ces sortes de gens ; ceux qui gouvernent sont toujours prêts à les écouter.
Les Athéniens portaient autrefois des cigales d'or dans leurs cheveux. C'était là le bon vieux temps ; comme qui dirait à présent les collets montés.
Les riches étaient obligés d'armer des galères

52
pré[?]face►
galères. Chacun affectait de paraître pauvre pour s'en dispenser ; et les magistrats qui voulaient se venger de quelqu'un, le faisaient inscrire dans le rôle des riches pour le ruiner, pendant qu'ils en faisaient rayer leurs amis véritablement aisés, pour les décharger d'une dépense onéreuse. C'est tout comme chez nous au sujet de la taille et de la capitation. A propos des galères, celles des Grecs n'étaient pas comme les nôtres. Elles avaient ordinairement trois rangs de rameurs les uns sur les autres, d'où est venu le nom de trirèmes affecté aux galères. Le premier rang d'en bas s'appelait les Thalamites, et le second les Zygites ; et le troisième ou supérieur s'appelait les Thranites. Les Thranites, selon la remarque burlesque d'Aristophane, pouvaient péter au nez des Zygites, et il ne tenait qu'à ceux-ci d'en faire autant aux Thalamites.
C'était un crime capital que de porter des vivres aux ennemis. Il était aussi défendu sous de très sévères peines de leur vendre des cordages, de la poix, du goudron, du lin, enfin de quoi équiper leurs vaisseaux.
Les marchands étaient dispensés de s'enrôler pour la guerre. On écrivait au bas de la statue de Pandion les noms de ceux qui étaient enrôlés, et il fallait que tous ceux dont les noms étaient là partissent quand l'ordre venait.

53
pré[?]face►
l'ordre venait.
Il y avait à Athènes deux navires fameux, l'un nommé Paralos, dont on se servait pour porter ce qu'il fallait pour de certains sacrifices publics qui se faisaient assez loin d'Athènes. L'autre s'appelait la Salamine, qui voiturait à Athènes les criminels appelés au jugement.
Chaque tribu à Athènes nourrissait un poëte de Dithyrambes. Les Dithyrambes, dans leur origine, étaient des Odes Bachiques, et on les appelait Dithyrambes par allusion aux deux thyres ou portes par où Bacchus était entré au monde, le sein de Sémèle et la cuisse de Jupiter. Depuis on appela Dithyrambes tous les hymnes faits en l'honneur des Dieux. Ces sortes de poésies avaient pour caractère l'enflure et l'enthousiasme.
La manière d'exposer les criminels au pilori était de les lier à une planche.
Il fallait avoir trente ou quarante ans pour pouvoir monter sur le théâtre et réciter des pièces. On dit que les Chevaliers d'Aristophane furent la première pièce où il lui fut permis par la coutume de réciter lui-même.
Les boutiques des barbiers étaient des bureaux d'adresse pour toutes les nouvelles du temps, soit que les barbiers fussent de grands jaseurs, soit que ce fût un rendez-vous

54
pré[?]face►
un rendez-vous ordinaire de nouvellistes de profession
désœuvrés. Il est sûr cependant que la plupart des Athéniens portaient de grandes
barbes, comme il est évident par la comédie qui a pour titre l'Assemblée des femmes. À quoi servaient donc ces barbiers ? Peut-être
ne laissait-on voir cette grande barbe que quand on la jugeait en état de foisonner
d'une manière qui fît honneur au menton qui la devait porter.
Les habits des Athéniens étaient une robe et un manteau, ou casaque au lieu de manteau. Leurs souliers ou soques étaient de cuir, qu'on avait soin de noircir de graisse noire avec une éponge. Ils étaient liés avec des courroies de cuir. Il est fait mention d'une espèce d'écorce dont on faisait des habits, appelée amorgis, qui se taillait comme du chanvre. Il est parlé de la pourpre de Sardes, comme d'un étoffe précieuse dont il n'y avait que les plus riches qui s'habillaient. Ceux qui conduisaient des chars avaient des manteaux de pourpre, et tant ceux-là que les chevaliers, avaient grand soin de leur chevelure. Les habillements des esclaves pendant l'hiver, étaient des vestes courtes, des surtouts de peau et des bonnets de peau de chien. Quand il

55
pré[?]face►
Quand il entrait à la maison un domestique nouveau, l'on répandint devant lui des
figues, des noix, des échantillons de tout ce qu'il y avait au logis pour lui faire
voir qu'il entrait dans une bonne maison condition.
Quand les maîtres étaient soupçonnés de quelque crime, on donnait la torture à leurs
esclaves. On ne maltraitait les personnes libres qu'après une pleine conviction. Du
reste, pour les corrections communes, il paraît qu'on avait si grand peur de les
blesser, que les châtiments que l'on employait faisaient plus de honte et de peur
que de mal. De là vient qu'on ne fouettait les personnes libres qu'avec des poireaux
et de l'ail vert ; et la férule, dont les pédants barbares de nos jours écrasent les
tendres mains des jeunes enfants, n'était alors que la fragile tige d'une plante
assez faible, pareille à la tige du panais, qui ne pouvait pas faire grand mal à
ceux que l'on voulait corriger. Pour ce qui est des esclaves, on les liait à des
arbres et à des colonnes, et on les punissait cruellement. Pour éviter ces terribles
châtiments, ils se réfugiaient aux pieds de quelque statue des Dieux, et c'était un
asile inviolable. La manière dont ils portaient ordinairement les fardeaux, étaient
de les pendre aux deux bouts d'un bâton, et de mettre le bâton sur l'épaule

56
pré[?]face►
sur l'épaule. Les esclaves avaient la tête rase, et de là vient que Pisthétaire, dans les Oiseaux, dit au poëte : si tu es esclave des Muses, d'où vient que tu as une grande chevelure ?
Si les hommes prenaient eux-mêmes la peine d'aller au marché, à la poissonnerie et à la boucherie, ils n'étaient pas moins ménagers à la maison. Ils regardaient à tout et se faisaient rendre compte des moindres minuties. D'abord, un simple crochet de fer servait à ouvrir toutes les serrures ; mais la malice des femmes et des esclaves ayant rendu les hommes plus soupçonneux et plus défiants, ils inventèrent des serrures renforcées, qui ne pouvaient s'ouvrir qu'avec des clefs à double et triple entaillure, et qui avaient plus de trous que du bois vermoulu. Aussi quand ils rentraient au logis, c'était à qui leur ferait le plus de caresses, pour captiver leurs bonnes grâces, et en excroquer quelques douceurs. La fille de la maison sautait au cou de son père, le baisait la langue dans la bouche, lui lavait les pieds, &c. La femme d'un autre côté faisait des caresses à son mari en lui présentant quelque friandise. Mais ce n'était pas simplement par un transport de tendresse qu'on les baisait à la bouche. La bouche de ces bons messieurs

57
pré[?]face►
messieurs leur servait de bourse, et cette langue amoureuse que l'on y enfonçait était souvent une voleuse qui raflait la monnaie du bonhomme.
Cette monnaie consistait ordinairement, comme on l'a dit, de trois oboles qui pouvaient valoir trois sous. D'où il faut conclure, où que les vivres étaient à grand marché, ou que les Athéniens vivaient très frugalement. Cependant il est fait mention de quelque repas où il y avait bien des mets différents. Il faut tout dire : c'étaient des repas publics, et voici la liste des plats d'un de ces festins. Du poisson de différentes sortes, entr'autres des lamproies, têtes de veau, ragoûts, hachis, herbes épicées, sauce à l'ail, moutarde, sauces au miel, bécasses de mer, mauvis2, merles, pigeonneaux, poulardes rôties, tourterelles ; item levreaux au moût &c. Les poissons délicats étaient un mets recherché des personnes riches, qui en étaient fort friands. Il est marqué en quelque endroit d'Aristophane qu'on arrosait le rôti avec de l'huile ; mais il faut savoir que l'huile de ce pays-là valait bien le meilleur beurre de celui-ci. Le principal repas était le souper. On allait au bain avant que de souper, surtout quand on mangeait dehors. L'heure ordinaire du souper était quand l'ombre du cadran était de dix pieds de long

58
pré[?]face►
de long, ce qui nous ferait juger que les cadrans étaient horizontaux et à style droit, qui marquaient les heures par l'intersection que faisait la ligne ombrale avec le lieu du soleil marqué dans le zodiaque du cadran. Dans les repas de débauche il y avait des joueuses de flûte et des danseuses dont on faisait ce qu'on voulait. Toutes ces femelles, aussi bien que les filles de joie, étaient esclaves et destinées à essuyer toutes les brutalités amoureuses d'un peuple fort licencieux. Les joueurs de flûte, et les joueuses aussi, se bridaient les joues avec des liens de cuir, et ce fut la mauvaise figure que faisaient les joues enflées et bridées qui dégoûta Minerve de continuer à se perfectionner dans un art qu'elle avait inventé. Après avoir mangé, on passait la meilleure partie de la nuit à boire, et à chanter, tant à voix seule qu'en concert et avec l'accompagnement de la lyre. Ceux qui voulaient chanter des vers d'Eschyle, prenaient une branche de myrte. On chantait aussi des Scolies, qui étaient ou des airs à boire ou des airs sérieux. On ne donnait pas le temps à celui qui avait commencé un air de l'achever ; on l'interrompait en substituant une autre

59
pré[?]face►
une autre chanson qui faisait un pot-pourri ; et cela continuant à la ronde faisait quelque chose de pareil aux mille et un airs dont on a régalé le public en 1713. Nous avons dans les Guêpes d'Aristophane un exemple de ces scolies qui est assez divertissant. On y renvoie le lecteur. Il ne faut pas confondre Scholies avec Scolies. Le premier terme vient d'un mot grec qui signifie loisir, et s'emploie pour indiquer des notes savantes que produit le loisir des hommes de lettres. L'autre terme est destiné à marquer des propos coupés, à cause que le terme de Scolies signifie quelque chose de gauche. Or à la fin du repas, quand on était un peu échauffé, on ne donnait plus la lyre ou la coupe de suite, mais au hasard, à la traverse, et celui qui était attaqué de la sorte était dans l'obligation de faire scolie et de coudre quelque nouvelle chanson à celle qui était commencée. Timocréon de Rhodes avait fait une scolie contre Plutus, qui est rapportée par les commentateurs grecs d'Aristophane, et la voici : « Tu devais, aveugle Plutus, ne paraître ni sur terre ni sur mer ; tu devais habiter le noir Tartare et les bords de l'Achéron, car c'est à toi que l'on est redevable de tous

60
pré[?]face►
de tous les maux de la vie ». Comme les Athéniens buvaient longtemps, ils avaient établi, pour empêcher qu'on ne s'endormît à table, de donner le pyramus à celui qui avait passé la nuit sans dormir. C'était un gâteau fait de miel bouilli et de blé rôti, ragoût excellent pour ceux qui l'aimaient. Un des divertissements du repas, c'était de Cottabiser, et voici ce que les Scholies Grecques nous apprennent de cet exercice inventé par les Siciliens. On plantait un bâton au milieu de la salle, et sur le haut du bâton, en travers, un joug de balance, des deux bouts duquel pendaient deux bassins de balance. Sous chaque bassin était un vase plein d'eau, et dedans une statue de cuivre doré appelée Manès. On jetait dans un de ces bassins ce qui restait de vin dans la coupe, après avoir bu. La rencontre du bassin avec l'eau et le Manès faisait un bruit appelé Cottabis, et celui qui avait le mieux fait croyait être le plus agréable à sa maîtresse.
Ce qui est dit dans les Oiseaux de la vapeur bénigne du fourneau qui échauffe les hommes pendant l'hiver en dardant

61
pré[?]face►
en dardant ses rayons de tous côtés, nous porte à croire, par ce terme de vapeur, que les Grecs ne se chauffaient pas à un feu clair et à une cheminée comme nous ; mais que leurs appartements étaient échauffés par des fourneaux comme chez les Romains. Et en effet, par rapport à ceux-ci, nous ne voyons point que leurs anciens auteurs qui ont traité de l'architecture aient fait mention des cheminées des appartements, ni des moyens de les empêcher de fumer, ce qui fait une des principales attentions des architectes modernes de France. Les Allemands, les Hollandais et beaucoup d'autres nations du Nord s'en tiennent encore aujourd'hui à la pratique des anciens Grecs et Romains pour se chauffer à la vapeur du fourneau. Et même dans les plus beaux palais de Rome, les cheminées y sont fort rares. On tient qu'elles défigurent un appartement, et l'on s'y sert de brasiers au lieu de cheminées. Il n'y avait, parmi les Grecs, que les gueux qui se chauffassent au feu clair. Ils se rendaient pour cela aux fourneaux des bains, et le devant de leurs jambes tavelé marquait assez qu'ils avaient senti de près un feu clair et ardent.
Aristophane fait

62
pré[?]face►
Aristophane fait mention de quelques jeux des Athéniens, comme les dés, les osselets, pair ou non, gobe en gueule, et la caille battue. On connaît assez les trois premiers. Pour ce qui est de Gobe en gueule, c'était un jeu du menu peuple fainéant. On jetait en l'air quelque fruit, ou autre chose, et on le recevait dans la bouche. Pour ce qui est de la caille battue, il paraît que c'était un jeu d'enfant. Les Athéniens étaient fort déréglés sur l'article de la continence. L'usage libre des femmes abandonnées était si peu interdit que les philosophes même n'avaient pas honte de se servir d'une chose permise à tout le monde. Nous avons là-dessus l'exemple du divin Platon, qui a fait des vers amoureux pour une vieille, et celui de Diogène qui faisait avec aussi peu de retenue les actions les plus sales que les plus sérieuses. Mais la lubricité de ce peuple licencieux ne s'en tenait pas là ; on corrompait aussi les femmes mariées, et toute la punition d'un aussi grand crime, quand on prenait le galant sur le fait, était de lui fourrer une grosse rave dans le derrière et de lui arracher le poil. Violer sa sœur de père, n'eût pas été un crime

63
pré[?]face►
crime horrible et criant ; mais violer sa sœur de mère, c'était un crime impardonnable. Voyez les Nuées où Aristophane reproche à Euripide d'avoir mis sur le théâtre Macaréus qui viole sa sœur de mère. Les Athéniens n'ont pas borné leur lubricité au sexe différent du leur ; ils se sont adonnés honteusement à l'amour des garçons ; et ces infâmes patients, si nous en croyons Aristophane, composaient le plus grand nombre des spectateurs. Cependant quoique ce crime horrible ne fût qu'une galanterie, on ne laissa pas de punir de mort un nommé Grytte corrupteur de la jeunesse. On peut dire à cette occasion que le vice était commun ; mais qu'il était dangereux d'être convaincu de prostituer les jeunes gens et d'en faire métier. Du reste le penchant de la plupart des particuliers les portait à cet amour criminel condamné par la nature. On allait, avec un corps corrompu et des yeux pleins d'une ardeur lubrique, voir les enfants à l'école et à l'Académie. On s'attachait à considérer les vestiges de leur corps dans les places où ils s'étaient assis sur le sable ou sur la poussière. On baisait tendrement ces enfants, on les reconduisait, on leur mettait la main sous la robe pour les caresser ; on leur faisait des présents ; enfin on n'oubliait rien pour les amener

64
pré[?]face►
les amener au point qui faisait l'objet de la passion brutale d'un amour honteux et détestable. Il faut même ajouter, à la honte des Grecs, qu'un de leurs plus sages législateurs, le grand Lycurgue, avait ordonné ou permis cet amour infâme, comme un lien de la société virile.
Ces hommes, qui se connaissaient si déréglés, avaient sujet d'être jaloux de leurs femmes, et de leur permettre rarement de se montrer à la porte et à la fenêtre. Cette extrême contrainte et les débauches de leurs maris au-dehors les obligeaient à avoir recours à des instruments de cuir de huit travers de doigt de long appelés Olisbes ou Glissoires, dont les Milésiennes, femmes fort lubriques, furent les inventrices ; maudite invention, qui fut renouvelée dans le quinzième siècle par le Piovan Arlot curé de Saint Cresci auprès de Florence, le Rabelais de son temps, qui en répandit un bon nombre à Bruxelles, à Anvers, dans les différents voyages qu'il fit en Flandre sur les galères de la république de Florence. Les femmes d'Athènes, au défaut de ces instruments de Milet, en faisaient de tout ce qui leur tombait sous la main, d'étrilles pour la sueur, dont on se servait aux bains, de longues phioles d'huile de senteur, &c.
Les femmes de

65
pré[?]face►
Les femmes de distinction étaient vêtues de blanc et avaient la chevelure flottante. Elles portaient de petits tambours, comme ceux que nous appelons de Basque, à leurs assemblées dévotes. Elles n'y oubliaient pas le vin ; car on leur reproche de l'avoir aimé à l'excès. Elles étaient fort voluptueuses et s'étudiaient à inventer de postures capables de donner aux hommes du goût et de l'attachement pour elles. Les plus fameuses en ce genre ont été, Cyrène, surnommée aux douze postures, Elephantisse, Philenis et Astyanasse.
Comme elles se fourraient toujours parmi les hommes aux spectacles, Sphyromaque fit un décret par lequel il était ordonné que les femmes assisteraient aux spectacles à part, à moins qu'elles ne voulussent passer pour publiques ; en ce cas il leur était permis de se faufiler parmi les hommes. Le serment ordinaire parmi les femmes était ma to théo, par les deux déesses, c'est à dire Cérès et sa fille. La couleur chérie des femmes était le jaune ; ce qui nous donnerait à penser, à en juger par l'assortiment que font aujourd'hui les femmes des couleurs avec le teint, que les Athéniennes étaient brunes. Elles ne se souffraient de poil nulle part ; elles l'arrachaient partout ou le brûlaient. Elles se fardaient et mettaient

66
pré[?]face►
mettaient beaucoup de rouge. Leur ajustement ordinaire était une robe légère parfumée, un Strophium ou ruban de tête, la grande ceinture qui servait à replier la robe, un bonnet, une mitre ou coiffure relevée par le devant, et un voile ou une écharpe, la robe longue appelée encyclon, des souliers mignons, un manteau, et une agrafe d'orfèvrerie. Il y en avait qui se servaient de commodes postiches toutes coiffées. Elles avaient des robes de trois sortes : des légères et presque transparentes appelées cimberiques, d'autres robes qui ne se ceignaient point et qui étaient comme nos Andriennes ou robes détroussées et s'appelaient Orthostades, c'est à dire robes droites ; enfin elles avaient d'autres robes rouges teintes d'orcanette. Elles étaient adroites à sauver leurs galants. Aristophane rapporte un bon tour d'une femme qui montrait sa robe au jour à son mari, et s'en servait de rideaux pour faire échapper le galant qui sans cela était en danger d'essayer la rave. Rien n'était si commun parmi elles que de supposer des enfants. On les apportait dans un pot, la bouche fermée d'un boule de cire pour les empêcher de crier ; et ce qu'il y avait d'heureux pour faciliter ces suppositions, c'est qu'il paraît que les hommes n'assistaient point aux couches de leurs femmes. Les mariages

67
pré[?]face►
Les mariages se faisaient la nuit, et c'eût été un signe de très mauvais augure s'il eût plu la nuit qu'on se mariait. On aurait plutôt remis le mariage à une nuit plus sèche plutôt que de s'exposer aux malheurs annoncés par un tel présage. Les termes de caresse d'un amoureux à sa maîtresse étaient à peu près ceux-ci : ma belle toute d'or ; beau rameau de Vénus, abeille des Muses ; nourrisson des Grâces, petit minois délicieux ; hanneton doré.
Les fausses subtilités qu'Aristophane met dans la bouche du vieillard Strepsiades dans les Nuées au sujet du dernier jour du mois lunaire appelé la vieille et nouvelle lune, nous donne lieu d'expliquer ici de quelle manière les Athéniens comptaient les jours du mois. Chaque mois était un mois lunaire composé de trente jours. Le premier était appelé le premier du présent ; le 2e, le 3e, &c jusqu'à dix étaient de même nommés le 2, le 3 &c du présent. Le onze on disait : le premier du milieu ou du mi-mois, et l'on continuait de même jusqu'à 20. Le 21 et le suivant jusqu'à 30, on comptait le 10, le 9 de la fin du mois ou du mois finissant, jusqu'au 30 qui s'appelait la vieille et la nouvelle lune exe kai néa. Ce jour

68
pré[?]face►
Ce jour était redoutable pour les débiteurs, car c'était le terme pour payer les intérêts ; et l'on peut voir dans les Nuées la manière dont on assignait ceux qui se faisaient, comme on dit, tirer l'oreille. À la nouvelle lune, on se frottait le corps d'huile, on offrait de l'encens &c. Le premier jour de la lune était aussi jour de marché. On peut juger de là que l'aspect de la nouvelle lune n'était triste que pour ceux qui devaient de l'argent, et que c'était un jour de fête pour tous les autres. C'était de même une grande réjouissance quand on voyait paraître le milan au retour du printemps. On se roulait de joie, on sautait, on gambadait ; surtout les gueux, à qui l'hiver est fort incommode.
Comme il y avait beaucoup de fripons à Athènes, qui dressaient des embûches la nuit, tant à l'honneur des femmes qu'à la bourse de leurs maris, les Athéniens, soigneux de conserver sûrement l'un et l'autre, faisaient garder leurs portes par des chiens vigoureux et de très mauvais humeur. Les femmes ne s'accommodaient guère de ces vilains grondeurs ; mais elles faisaient leurs délices de petits chiens de l'île de Sériphe. Ce chien mignon et si beau à qui Alcibiade coupa la queue, afin que, ne parlant que de cela, on oubliât de parler d'autre chose, était apparemment

69
pré[?]face►
apparemment de la même île.
Si l'on avait soin de bien garder les maisons, on n'en avait pas moins de veiller exactement à la garde de la ville. On faisait la ronde sur les murs avec une grande vigilance, et ceux qui faisaient la ronde marchaient avec une sonnette, pour avertir qu'ils étaient dans leur devoir.
Le toit des maisons était en terrasse, et c'était là où l'on faisait souvent de chœurs en chantant : pleurons Adonis.
Il paraît qu'à Athènes il n'y avait point de lieux communs dans les maisons, et qu'il y avait des gens gagés qui le faisaient d'eux-mêmes pour un prix modique, qui allaient frapper de bon matin à toutes les portes et enlevaient toutes les ordures, comme le font à St Malo les femmes que l'on appelle Porteuses.
Pour marcher la nuit, outre les flambeaux de poix, de résine, et de bois de pin, on avait aussi des lampes renfermées dans des lanternes d'osier.
Il paraît par les comédies d'Aristophane qu'on ne brûlait point les corps morts à Athènes. On les mettait dans un cercueil avec des aromates &c. On y joignait un pain pour le chien Cerbère, et une obole pour payer le passage du Cocyte à Caron. Aristophane nous représente quelque part l'attirail d'un corps mort : de la marjolaine, des feuilles de vigne, de l'huile, une coquille

70
pré[?]face►
une coquille pleine d'eau pure à la porte, une couronne sur la tête du mort et des cierges. Les sculpteurs représentaient sur les tombeaux des lampes en relief.
Il nous reste quelques petites remarques à faire sur les voisins d'Athènes et les étrangers. Les Lacédémoniens étaient curieux de nourrir une grande et belle chevelure. Ils étaient sobres, mal-propres, moqueurs, avares, et portaient de gros bâtons courts. Il est parlé, dans la comédie qui a pour titre Lysistrate, de la Scytale Laconique. C'était une espèce de lettre en chiffre, et voici comme elle s'écrivait et se lisait. Quand la république envoyait un ambassadeur, ou un général ou quelque autre officier, quelque part où l'on prévoyait qu'on pourrait avoir occasion de lui donner quelques ordres secrets, ou bien d'où l'on espérait de recevoir de lui quelques nouvelles d'importance, on lui donnait un bâton d'une grosseur pareille à celle d'un bâton semblable qui se gardait à Lacédémone. On roulait sur ce bâton une bandelette de vélin ou de papier, et l'on écrivait tout du long du bâton ce que l'on voulait faire savoir. Après cela on ôtait la bandelette, et il était impossible de trouver la suite des mots coupés à moins que d'avoir le bâton sur quoi cette bandelette devait s'ajuster, ou d'en savoir au juste la grosseur.
Les Lacédémoniens

71
pré[?]face►
Les Lacédémoniens avaient une danse particulière appelée la danse laconique, ou saut de la pie, qui se faisait à pieds joints, au son de la flûte. À Lacédémone on chassait les bouches inutiles, et l'on y battait les étrangers.
Thase et Chio produisaient des vins de grande réputation.
Les peuples de Candie avaient inventé une danse appelée le branle de Candie. Il paraît que c'était une danse où les cuisses et les reins avaient beaucoup de mouvement.
Les Thébains ainsi que les Mégariens étaient des grands joueurs de flûte.
Parmi les Perses il n'y avait que le roi qui eût le droit de porter la thiare droite.
Les anciens rois des villes grecques portaient des oiseaux sur leurs sceptres.
Il nous reste, pour finir cette préface, de faire connaître beaucoup de poëtes, dont Aristophane nous a conservé les noms, et de rapporter les caractères qu'il a mis sur la scène. Nous commencerons par les poètes, et nous nommerons les Comiques les premiers.
Il est juste qu'il passe d'abord en revue lui-même. Il était chauve et n'a pas oublié de se railler lui-même sur ce sujet. Il avait des terres en Egine, et il se flattait que quand les Lacédémoniens faisaient instance pour

instance pour avoir l'île d'Egine, c'était pour acquérir un poëte qui devait, au sentiment du roi des Perses, rendre infailliblement meilleurs ceux qui suivaient ses conseils. Il était sage dans ses mœurs et se sait bon gré de la pratique qu'il avait de faire lever les toiles aussitôt que la représentation était finie, afin que l'on eût pas lieu de profiter de cette couverture pour venir cajoler les jeunes garçons derrière la décoration. Tous les autres poëtes que nous allons nommer sont, ou plus anciens que lui, ou tout au moins de son temps.
Cléonide et Callistrate s'approprièrent les Daitalées d'Aristophane.
Eupolis, dans son Maricas fait contre Hyperbole, avait frappé les chevaliers de notre auteur.
Hermippe a aussi joué Hyperbole.
Phrynique, Lycis et Amipsias étaient trois poëtes comiques qui introduisaient toujours des valets portant des fardeaux. Le même Phrynique faisait lutter ses chœurs. Aristophane lui reproche encore d'avoir fait une Andromède burlesque représentée par une vieille ivrognesse qu'un monstre marin dévorait.
Platon, poëte comique, auteur d'une pièce intitulée Cléophon.
Cratin, ivrogne fameux, qui pissait sous lui et gâtait ses tapis de peau de mouton. Il avait eu une vogue extraordinaire dans son jeune temps, et tout ce qu'on chantait dans les repas

dans les repas était pris de ses pièces. Mais sur la fin il était tombé dans le mépris.
Philoclès, neveu d'Eschyle par sa sœur. Il était dur et amer, et à cause de cela, on l'avait surnommé Almion.
Magnès, vieux poëte, avait fait les Joueuses de Lyre (Barbitides), les Oiseaux, les Lydiens, les Charrues et les Grenouilles. Étant vieux, il était déchu de réputation, aussi bien que Cratin.
Cratès, acteur de Cratin, s'érigea depuis en auteur, en faisant de petites pièces, comme nos Dancour et nos Montfleuri.
Voilà les anciens poëtes comiques dont Aristophane nous a conservé la mémoire.
Hipponacte et Ananias paraissent avoir précédé Aristophane, aussi bien qu'Eschyle. Celui-ci est représenté dur, sans liaison, et affectant de grands mots capables de nous faire casser le cou. Du reste, c'était un homme religieux, qui avait été initié aux mystères de Cérès. Avec cela il faut lui rendre la justice d'avouer qu'il est le premier qui ait entrepris de donner de la gravité aux jeux de théâtre.
Carquin, poëte tragique, n'était pas estimé d'Aristophane.
Xénocle, fils de Carquin, s'avisa aussi de faire des tragédies. Il était frère de deux danseurs, Xénotime et Démotime. Aristophane a souvent raillé le père et les trois fils.

74
pré[?]face►
Sophocle. Aristophane n'en parle qu'avec estime, et il a raison. Il y a beaucoup plus de conduite et de correction dans ses pièces que dans celles d'Euripide. Il nous reste sept Tragédies de Sophocle. Aristophane en cite une huitième intitulée Laocoon, dont il rapporte deux vers dans les Grenouilles.
Euripide a toujours été fort estimé, quoique Aristophane en ait dit beaucoup de mal. Il lui reproche qu'il était fils d'une cressionière, qu'il avait une voix de fausset, qu'il affectait de petits mots coulants, qu'il avait énervé la tragédie et mis sur le théâtre des crimes dont il fallait plutôt étouffer la mémoire. Il lui reproche encore des vaines subtilités, et sa mort avancée par la galanterie. Il nous le représente aussi comme grison et barbu.
Iophon, fils de Sophocle, plagiaire de son père, diffus et froid.
Le poëte Agathon est représenté par notre auteur comme un homme efféminé, beau, blanc, qui avait toujours la barbe rase, une voix de femme, le teint délicat, la peau douce ; enfin qui faisait assez souvent l'office de femme.
Pythange était un très mauvais poëte.

Morsime était un auteur médiocre, mou et plat, passablement bon oculiste, fils de Philoclès et père d'Amphidamas. Aristophane suppose qu'on punissait vigoureusement aux enfers ceux qui avaient perdu le temps à copier des passages de Morsime.
Cinésias était un musicien de Thèbes, qui s'avisa de faire des tragédies. Il était extravagant dans sa composition.
Phrynique avait fait l'Anthée gladiateur. Il était plus ancien qu'Eschyle et disciple de Thespis. Il fut le premier qui fit paraître des femmes sur la scène.
Mélite, ennemi et accusateur de Socrate, se mêlait de faire des tragédies. Il était froid. Il en est parlé dans les Grenouilles.
Théognis, poëte tragique, froid.
Iéronyme, poëte ridicule et sans jugement, introduisait des masques horribles capables d'effrayer les spectateurs.
Philoclès fit aussi des tragédies dont on ne dit ni bien ni mal.
Amipsias était un mauvais poëte.
Sthénèle était un poëte si gueux qu'il vendait les habits de ses acteurs pour vivre.
Acoestre ou Acestor, autre poëte tragique, passait pour étranger ; et c'est pour cela qu'Aristophane le surnomme Saque.
Mélanthe était galeux, lépreux, puant, et friand ;
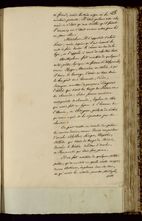
76
pré[?]face►
et friand ; avait la voix aigre et la mâchoire pesante. Il était galant avec cela ; mais ce n'était qu'aux vieilles qu'il faisait l'amour ; et c'était encore assez pour lui et pour elles.
Stésichore. Il s'appelait d'abord Tisias ; mais depuis qu'il eut inventé la mode de faire danser le chœur au son de la lyre, on l'appela à cause de cela Stesi-chore.
Aristophane fait mention de quelques autres poëtes lyriques et faiseurs de Dithyrambes, comme Ibyque, Anacréon, et Alcée, à qui il donne la louange d'avoir eu tous trois le bon goût de l'harmonie ; Cécide, Iéronyme amateur de garçons, Diagoras l'athée qui vivait du temps de Pindare et de Simonide ; Ladus fameux musicien antagoniste de Simonide, Ïophon de Chio qui avait fait un hymne à l'honneur de l'Aurore, et Clitagora, prêtresse de Lesbos, qui avait acquis de la réputation par ses chansons.
On peut mettre au nombre des poëtes les anciens devins, comme Bacis, compositeur d'Oracles Sibyllins, Lampon, Diopithe, Stilbise qui vivait du temps de Nicias, Iéroclès le Béotien débiteur d'oracles, et Thoumantis qui était fort gueux.
Il est fait mention de quelques autres poëtes, qu'on ne sait en quelle classe ranger, comme Arténon, impétueux dans les vers, et qui avait les aisselles puantes, Aristylle, poëte
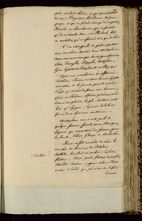
poëte insolent, obscène, et qui parlait du nez ; Phrynique, bel homme toujours propre et qui ne faisait rien que de mignon ; Xénocle, méchant homme qui ne faisait que de méchants vers ; et Philocle, laid et malotru, qui ne faisait rien que de laid.
C'est assez parlé des poëtes ; passons aux caractères touchés dans Aristophane. Nous commencerons par les ivrognes fameux : Sosie, Deroylle, Hippile, Antiphon, Lycon, Lysistrate, Théophraste et Phrynique.
Après eux marcheront les efféminés : Clisthène, Pauson, méchant homme, Grytte corrupteur de la jeunesse puni de mort, Prepis qui servait de femme aux hommes, Gérès et Théodore, officiers généraux mais adonnés aux plaisirs les plus honteux, aussi bien qu'Epigone.
Aristophane nous a aussi parlé de quelques fameux friands, comme Monique, Léogoras qui nourrissait des faisans pour la bouche, Teleas, Glauque et Melanthe.
Il nous a fait connaître de même le caractère de beaucoup de Rhéteurs : Evathlès, braillard et archer, Euphème, flatteur ; Théoresic grand flatteur du peuple ; Néoclide chassieux et grand voleur ; Phéax orateur si habile que, pris même sur le fait, il avait
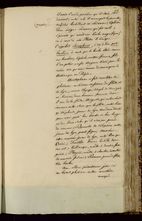
il avait l'art de persuader qu'il était innocent ; outre cela il corrompait la jeunesse ; Marpsias babillard et chicaneur ; Céphisodème insigne chicaneur qui fut exilé ; Epicrate qui avait une barbe magnifique et à cause de cela Platon le comique l'appelait Sacosphoros, c'est-à-dire porte-bouclier, à cause que sa barbe était comme un bouclier ; Céphale, auteur fameux, fils d'un potier ; enfin Amynon décrié pour le même vice que nous venons de marquer à Antimaque et Prépis.
Aristophane a fait mention de plusieurs musiciens et joueurs de flûte et de lyre, comme Olympe, disciple de Marsyas, et Konnad, deux hommes connus dans l'art de la flûte ; Arignote, qui embouchait souvent autre chose que la flûte, aussi bien qu'Ariphrade joueur de lyre, tous deux décriés pour avoir porté leur bouche et leur langue en des lieux sales qu'il n'est pas permis de nommer ; Polymneste de Colophon autre joueur de lyre, grand fripon ; Moschus assez mauvais joueur de lyre, aussi bien que Quéris ; Déxithée, homme habile dans cet art ; Callimaque, maître à danser fort gueux ; Phrynis, maître à chanter, inventeur de mauvais fredons ; Pronome, joueur de flûte, très barbu.
Nous allons présentement jeter ici au hasard plusieurs autres caractères marqués
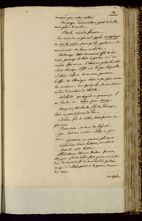
79
pré[?]face►
marqués par notre auteur.
Nicarque, dénonciateur, petit de taille, mais plein de malice.
Pittale, médecin fameux.
Les médecins en général appelés scatophages, ou mâche-merde, parce qu'ils goûtaient les excréments de leurs malades.
Antimaque était surnommé fils de la rosée, parce qu'il était importun et d'un mérite fort mince. C'était un poëte très sot. Etant chorègue, il fit une loi par laquelle il était défendu de nommer personne. L'office de Chorègue était à peu près comme la survivance des spectacles, des machines, et des décorations de théâtre.
Alcibiade grasseyait et prononçait l au lieu de r : colax, pour corax.
Amynias, archonte, fils de Pronape, était un grand joueur de dés.
Eschine fils de Sellus était pauvre et glorieux.
Proxeniade est taxé de légèreté.
Eagre était un orateur célèbre et fort couru.
Lysistrate, un mauvais plaisant.
Ephoudion vieux lutteur, excellent.
Asconde, autre lutteur.
Philoctemon était un traiteur fameux.
Amynias fils de Sellus, frisé, gueux, ambassadeur de mauvaise foi et malhabile, poltron, et qui n'allait point à la guerre, de peur des coups.
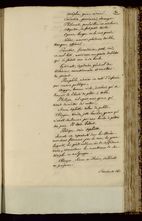
Antiphon, gueux et ruiné.
Exécestide, provincial, étranger.
Philocrate poulailler (sic) et oiseleur.
Atopodore, de fort petite taille.
Opunee, borgne et le nez grand.
Téléas, mauvais plaisant, double, trompeur, efféminé.
Panétius, ferrandinier, petit, laid et mal-bâti, marié avec une grande diablesse qui le faisait cocu à sa barbe.
Lysicrate, capitaine général des Athéniens, concussionnaire et amateur de présents.
Pamphile, usurier et noté d'infâmie pour censure publique.
Argyre, homme riche, insolent, qui se donnait la liberté de péter à table.
Philepse, bel esprit, mais gueux, qui vivait de récits et de contes.
Simon, sophiste, voleur du public.
Cléonyme, timide, jette-bouclier, gueux qui n'avait seulement pas une huche à pétrir son pain. Il était bâtard.
Prodique, vain sophiste.
Socrate est représenté dans les Nuées marchant fièrement par les rues, les yeux hagards, les pieds nus, un air de suffisance vaine, escamotant les manteaux de ses disciples et malpropre.
Cléonyme, Simon et Théore, scélérats et parjures.
L'archonteCléon
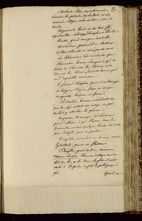
L'archonte Cléon, concussionnaire, aimant les présents, turbulent, criard, mauvais citoyen, calomniateur, mou, et timide.
Hippocrate, benêt, et ses trois fils, niquedouilles : Thélésippe, Démophon et Périclès.
Cratin, grand mangeur, insatiable.
Archédème, provincial et chassieux.
Callias, débauché et ruiné par ses excès.
Les Tithrasiens, très méchantes gens.
Théramène, homme changeant, qui se disait de Chio avec les Chiiens, et de Cio avec les Ciiens ; du reste homme poli et d'agréable commerce.
Le général Cléophon, ignorant et étranger.
Le baigneur Cligène, fripon et ivrogne.
Pentaclée, homme maladroit et gauche, qui mettait son casque et puis voulait y attacher des plumes.
Myrmax, Nichomaque, Archénome, gens d'affaires à qui Pluton, dans les Grenouilles, envoie quelques brasses de corde par Eschyle, pour se pendre.
Diopithe, manchot et la main creuse.
Lysistrate, pauvre et flatteur.
Phaÿlle, grand sauteur, surnommé Mesure-chemin. Dans un distique ancien fait sur lui, on lui donne la gloire d'avoir sauté à 55 pieds, et jeté le palet jusqu'à 95.
Quand on

82
pré[?]face►
Quand on voulait parler de quelque chose de froid, on mettait en jeu Lacratide, archonte du temps de Darius, pendant l'année duquel il fit beaucoup de neige.
Le général Tisamène, fripon.
Le général Phénippe, adonné aux femmes de médiocre vertu.
Diomée, hableur.
Mégaclès, fils de Cœsyre, dissipateur des grands biens de sa mère. Il se rempluma à voler celui du public. Ne serait-ce point donc l'oncle de Phidippides, des Nuées ?2
Ctésias, dénonciateur.
Le général Nicias, renommé pour l'invention des machines de guerre. Il était bel homme et avait la peau d'une grande blancheur.
Spinthat et Philémon, étrangers, oiseaux de passage.
Le fils de Pisias, traître à la patrie comme son père, et méditant de livrer les postes à l'ennemi.
Diitrephe, de tonnelier devint Philarque, et puis Hipparque ; c'est à dire capitaine de tribu et général de la cavalerie.
Le gros cochon Théagène, et Eschine, riches en imagination et en vanteries, gueux et fanfarons, mais dont la bourse était toujours vide.
Méton, fameux astronome et géomètre. Ce fut lui qui inventa le cycle lunaire de dix-neuf ans

83
pré[?]face►
de dix-neuf ans, appelé à cause de lui l'an Métonique, qui servait à ajuster le cours du Soleil avec les irrégularités de la lune.
Ménippe était un maquignon.
Pisandre, un homme lâche et timide.
Les poëtes Sophocle et Simonide aimaient l'argent.
Argyrius, général à Lemnos, était un homme efféminé, plus souvent femme qu'homme.
Aisime était boîteux.
Myronide, l'un des généraux qui avaient eu le plus de réputation.
Antisthène, médecin.
Euaion, ou Bon-temps, fameux débauché.
Lysicrate, camard, qui se teignait les cheveux en noir.
Erystille, puait le faguenas.
Callias, s'était ruiné au métier de l'enfant prodigue.
Gérès, vieux, chauve, et malotru.
Carixène était une femme de bien, mais sotte et simple.
Mnésiloque, beau-frère d'Euripide, était boîteux.
Phrunondas, insigne vaurien.
Eudame était un philosophe habile à faire des anneaux constellés ou talismans propres à empêcher les effets des maléfices.
Il resterait

84
pré[?]face►
Il resterait à parler de cette traduction comme Aristophane parle de lui-même dans ses Anapestes. Mais on n'en dira autre chose, sinon qu'on l'a faite avec le seul secours de l'original Grec et de ses anciens scholiastes qui ont écrit dans la même langue, sans avoir recours, ni à la traduction latine, ni à celle que feu Mme Dacier a faite de Plutus et des Nuées. On a mis des notes où elles ont été nécessaires ; mais on n'en a pas voulu surcharger les lecteurs, d'autant plus qu'on n'a pas écrit pour des gens à qui il fallût apprendre que Proserpine est fille de Cérès, ou Achille fils de Thétys. On n'a point distingué les actes et les scènes. Il serait difficile de trouver dans la plupart de ces onze comédies les cinq actes qu'on s'imagine qui en constituent toute l'économie. On a suivi l'original, et on ne lui a point prêté une distribution arbitraire. Dans les anciennes pièces de théâtre que nous avons en Grec, le chœur fait ordinairement la distinction des actes, quand, parlant seul, il fait l'éloge des Dieux ou quelque raisonnement général sur la matière qui l'a précédé ; mais au reste le chœur devient acteur, quand il prend part au dialogue des scènes particulières, qui varient selon les entrées

85
pré[?]face►
entrées des personnages différents qui se montrent sur le théâtre. Les auteurs Espagnols ont imité cette pratique et n'ont d'autre distinction de scènes que l'entrée et la sortie de chaque personnage qui y paraît.



